Un don Juan

Chapitre 1 | Chapitre 2 | Chapitre 3 | Chapitre 4 |Chapitre 5 | Chapitre 6 |
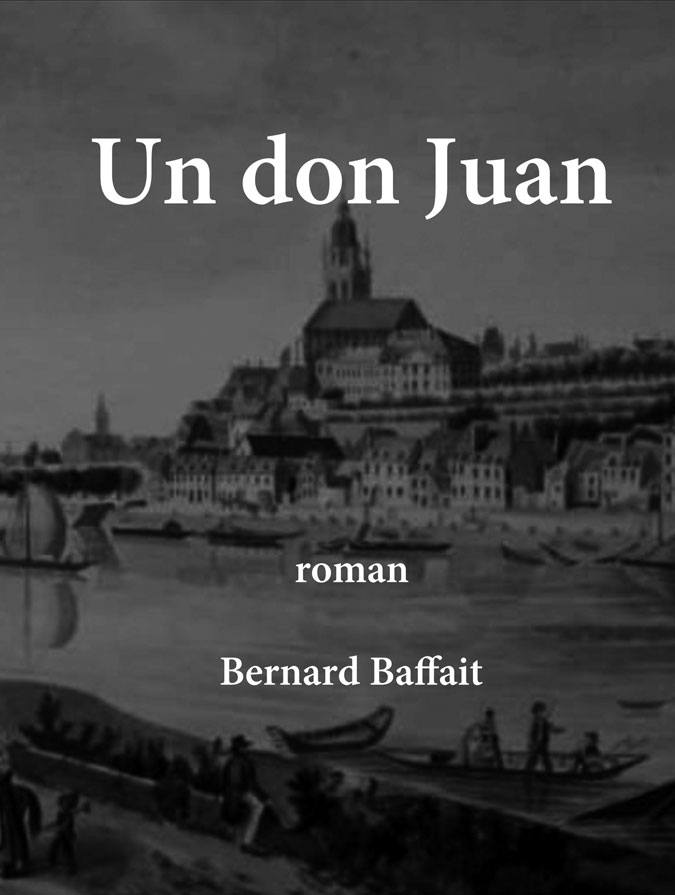
Préambule
C'est une histoire comme il en est tant, dans la vie courante, celle de la vengeance d'une femme. Un homme trompe sa femme. Celle-ci finit par s'en rendre compte. Et cependant, bien que banale, c'est une histoire tragique, qui dĂ©truit aussi bien le don Juan que lâĂ©pouse bafouĂ©e.
Chapitre 1 - Au fil de l'eau
Marion s’était accroupie au bord de la rivière. Il faisait très chaud, au bord de la roselière jaseuse bruissant de chuchotis, et elle transpirait. Des moustiques, des guêpes et bien d’autres bêtes volantes mal identifiées vrombissaient dans l’air humide et brûlant. Elle avait cru trouver au bord de la Cisse un peu de fraîcheur mais elle constatait qu’elle s’était trompée. Elle eût mieux fait de rester sur le haut de la colline, près de la maison grise accotée à la tour carrée qui s’élevait dans l’angle des bâtisses, au-dessus des immenses vignes qui escaladaient le côteau. Là-haut, elle pouvait un peu mieux respirer grâce à une brise presque imperceptible qui descendait de la forêt de Blois, au nord, à quelques centaines de mètres au nord de la crête, pour dévaler ensuite la colline en direction de la vallée de la Cisse. Dans le creux aquatique où elle était, l’air était lourd et immobile, chargé de pesantes senteurs de vase grasse et de plantes visqueuses à moitié décomposées.
Elle avait cru pouvoir conserver sa posture, adoptée d’abord pour ne pas avoir de contact avec le sol, où tout un peuple à peine visible d’insectes un peu répugnants se déplaçait. Mais son accroupissement devenait de plus en plus inconfortable, et elle se résolut à s’asseoir dans l’herbe jaunissante, en encerclant ses genoux de ses mains.
Elle contemplait, l’esprit à la dérive, l’eau grise qui coulait doucement, emportant parfois une brindille ou une Gerris – une araignée d’eau comme on l’appelle improprement – qui progressait par bonds saccadés à la surface de la Cisse. Des vairons, à moins que ce ne fussent des ablettes, qui se déplaçaient par bancs, apparaissaient et disparaissaient par moments, fuyant l’approche devinée d’une carpe menaçante, à la bouche dédaigneuse. Le fond de la rivière était de sable clair et graveleux en bordure de rive, mais devenait rapidement sombre. La vase molle du lit de la Cisse permettait à de longues herbes d’un vert éteint de s’étirer interminablement, ondulant doucement dans le courant. L’eau passait, comme la vie, incapable de remonter vers sa source. Elle eût volontiers rebroussé chemin, elle ! Pour ce que sa destinée lui avait apporté… Elle crut voir une grande ombre sinuer dans les herbes, et elle se redressa pour s’approcher encore plus au-dessus de la Cisse, afin de mieux observer la carpe. Mais le monstre lippu ne se montra pas - ou bien elle s’était trompée. Mais elle vit en revanche son reflet à la surface miroitante de l’eau. Elle observa avec anxiété la femme très mince au cheveux blonds couverts d’un ample chapeau de paille qui la regardait dans le miroir de la rivière. Elle n’en voyait pas les yeux, mangés par l’ombre agitée de petites ondulations. Sa minceur faussement juvénile ne trompait pas longtemps les gens lorsqu’ils l’approchaient et qu’ils voyaient son visage. Son image sur l’onde était évanescente, comme peut l’être une vieille, très vieille photographie sépia du dix-neuvième siècle, aux personnages gommés par le passage du temps.
Elle esquissa un sourire triste et murmura : « « Le temps s’en va, le temps s’en va madame. Las ! Le temps, non, mais nous nous en allons… »
Le temps était comme ce courant de la rivière, pour reprendre une métaphore usée, soupira-t-elle intérieurement. La réflexion nostalgique du bonhomme Ronsard s’accordait si bien avec cette solitude étouffante, indifférente aux peines de cœur d’une femme. Elle voyait derrière l’image à moitié effacée de son visage penché au-dessus de l’eau sombre le jeune visage plein de rires et éclatant d’espérance de la jeune fille qui, vingt ans avant, était tombée amoureuse de Claude, ce si séduisant jeune homme. Dieu ! Que la vie était alors grosse d’espérances, cette vie comme un portail en arc en ciel, au-devant de laquelle elle courait ! Ils allaient se marier, former un couple, s’aimer ! Ils allaient construire un nid, leur nid ! Elle mettrait au monde un enfant, deux enfants, qu’elle aimait déjà à l’avance de tout son cœur et de toutes les fibres de son corps…
Et puis, ils s’étaient mariés. Mais rien ne s’était passé comme elle l’avait rêvé. Ils n’avaient pas eu d’enfants et Claude, le si charmant Claude, le beau Claude, ce misérable Claude, s’était peu à peu écarté d’elle. Et elle demeurait là, seule, dans ce manoir ancien érigé en haut de la colline, qui lui avait été légué par sa grand-mère. Ils étaient toujours mariés, mais liés plus par de sordides intérêts que par l’amour. Ils partageaient une grande et noble demeure qu’ils avaient achetée vingt ans auparavant, au joli temps de leurs espoirs fous, dans les beaux quartiers de Blois. Le bâtiment de leur entreprise, un laboratoire d’analyses médicales, avait été construit à la place d’une vaste grange voisine. Maintenant, quand son mari s’absentait pour ses affaires, elle venait bercer sa souffrance secrète et se réfugier dans cette propriété des Courtauderaies, sur les hauteurs de Chambon, de l’autre côté de la forêt de Blois. Le vieux manoir était à une douzaine de kilomètres de sa maison. Elle ressentait la traversée de la forêt au volant de sa voiture comme un bain lustral, une purification parmi ces innombrables rameaux aux feuilles vertes qui ployaient à son passage, emportant tous les miasmes et les scories qui s’étaient accumulés sur son visage et son corps. Et lorsqu’elle arrivait à la barrière de bois de la propriété, et qu’elle descendait de son véhicule pour l’ouvrir et donner accès au grand mail ombragé de vieux chênes, conduisant au portail du potager, elle éprouvait le sentiment très fort de quitter un monde laid et triste pour entrer dans un domaine secret où se cachait une nouvelle source de bonheur. Oh ! un bonheur égoïste, un tout petit bonheur ! Mais dans le désert des sentiments on ne se montre pas très exigeant.
Claude était venu, bien sûr. Il avait arpenté la propriété avec un sourire indulgent. Après avoir parcouru enfin quelques allées du petit bois, qui s’étendait au nord et protégeait la maison des tempêtes de l’hiver, il avait lâché d’un air amusé : « Eh bien, tu vas pouvoir, à l’imitation de Rousseau, venir te cacher dans ton désert ! » Elle avait souri à son tour, comme d’un bon mot. Et lui, pourtant si fin, n’avait pas deviné que sa repartie qu’il croyait spirituelle exprimait en fait littéralement ce qu’elle ressentait.
Le manoir et ses dépendances constituaient un L. Un haut mur refermait, au nord et à l’est, les branches du L, protégeant un vaste potager et la cour d’honneur. Encore que cette dernière expression fût fort prétentieuse à désigner la petite étendue couverte de sable, qui longeait les communs. L’habitation avait une façade tournée vers la cour et l’autre façade orientée au sud, dominant une grande prairie retournée à l’état sauvage, aprĂšs laquelle la vue se perdait dans d’immenses vallonnements, au-delà de la vallée de la Cisse. Il fallait gagner l’extrémité de la prairie, marquée par un canal à moitié à sec, aux murets de pierre, pour découvrir les vignes qui descendaient vers la rivière. La petite route sinuait trois cents mètres plus bas, longeant le cours de la Cisse, mais un sombre bosquet touffu la dissimulait.
Claude… Elle l’avait tant aimé, le Claude. Tellement. Trop aimé. Quelle oie blanche elle avait pu être ! De quel aveuglement elle avait été victime ! Mais ses yeux s’étaient ouverts. Hélas ! Ou heureusement ? Maintenant, elle connaissait la réalité de sa situation, elle avait mesuré la noirceur de la trahison du beau Claude ! Elle ricana doucement : mais ma fille, tu tombes dans le grandiloquent ! La noirceur de la trahison…C’est un salopard. Un point, c’est tout. Inutile d’en faire un roman à la Dumas. Une parole est une parole. Il avait promis de t’être fidèle. Il n’a pas de parole. C’est un hypocrite qui joue encore à l’homme attentionné.
Elle feula soudain, envahie par la rage, puis, l’instant d’après, éclata d’un rire sans joie en prenant conscience de son bruit de gorge incongru. Heureusement que tu es seule, perdue au milieu des roseaux dans ce trou au fond de la campagne ; sinon tu passerais pour une folle, une hystérique !
Mais le beau Claude ne perdait rien pour attendre.
Elle eut d’un coup la gorge serrée, comme si une grosse boule s’était bloquée dans sa gorge. Elle ne pouvait plus respirer. Le chagrin l’envahit. Mais qu’est-ce qui lui prenait ? Elle avait à la fois envie de pleurer de rage, et même de hurler. Mais simultanément elle ne pouvait s’empêcher de revoir avec les tendres yeux du cœur ces jours et ces nuits pendant lesquels elle avait rêvé de Claude. Il l’avait aimée, il lui avait avoué son amour, et en quels termes ! Car il savait se montrer séducteur, ce beau ravageur. Il lui avait fait une cour pressante, même si cette cour s’apparentait parfois à une poursuite à la hussarde. Il l’avait au bout du compte épousée, mais peut-être parce qu’elle avait été inflexible ; il ne l’aurait qu’avec la bague au doigt. Plus tard, il l’avait trompée, et l’amour qui les rapprochait semblait alors s’être évaporé comme la rosée, qui transforme un temps une humble fleur des haies en un bijou scintillant mais qui laisse, quand les feux du soleil l’ont bue, la blanche marguerite fripée et desséchée. Cela la mettait très mal à l’aise. Elle éprouvait confusément un vif, un incompréhensible sentiment de culpabilité, comme si cet amour qu’elle avait ressenti pour Claude, et qui semblait subsister en un endroit secret de son esprit, lui reprochait de le haïr aujourd’hui. « Grand Dieu ! Je ne suis quand même pas coupable en quoi que ce soit ! » gronda-t-elle, les larmes aux yeux.
Elle avait la bizarre impression que plusieurs voix parlaient au fond d’elle-même, que leurs répliques coléreuses s’élevaient d’un puits obscur. Elle se représentait un kaléidoscope, réagençant dans une continuelle métamorphose les événements de sa vie, ou un puzzle constitué de plusieurs vérités revendiquant véhémentement leur authenticité. Mais qui était donc la véritable Marion, assise sur la margelle du puits ? Que voulait-elle, en fin de compte ? Aimait-elle ? N’aimait-elle plus ? Haïssait-elle vraiment celui qui s’était joué d’elle et courait maintenant la gueuse, en continuant à lui chanter de temps à autre des romances trompeuses ? Son regard plongea dans l’étendue d’eau grise, transparente près du bord, puis gagnant en turbidité avec la profondeur croissante. La rivière et ses clairs-obscurs, ses veines de courant secrètes, ses mystères et ses épouvantes, à l’image de son esprit. Plus j’essaie d’explorer ses profondeurs, moins j’y vois clair ; des monstres y nagent lentement sans que je puisse ou que je veuille les identifier, songeait-elle avec angoisse.
Chapitre 2 - Vingt ans avant
Elle avait vingt-deux ans. Claude était un peu plus âgé. Des jeunes gens appartenant tous deux à la bonne société de Blois.
La famille Alluyes y jouissait d’une réputation flatteuse. Le père de Marion avait développé à l’échelle industrielle les activités d’une entreprise artisanale de vinaigrerie que son propre père avait créée bien des décennies auparavant. Les Alluyes habitaient dans une vaste propriété qui s’étendait sur le plateau, au-delà de la voie ferrée, à peu de distance de la gare de Bois.
La famille de Claude Roberteau appartenait, elle aussi, à la bourgeoisie blésoise. Le père de Claude était décédé maintenant. Il avait créé en son temps une quincaillerie située dans la rue du Commerce, au beau milieu des principaux magasins de la ville. Ce n’était pas la célèbre et ostentatoire rue Denis Papin, mais on n’en était pas loin. Madame veuve Roberteau vivait dans sa belle maison rue du Puits-Châtel, sur les hauts de Blois, à cent cinquante mètres de la cathédrale Saint-Louis, où elle se rendait tous les matins pour y écouter la messe. Après quoi, elle descendait jusqu’à la rue du Commerce et surveillait l’ouverture de la quincaillerie Roberteau par ses employés. Elle se tenait le plus souvent à la caisse, mais elle servait parfois elle-même les clients, aux heures d’affluence. Sa maison en blanc tuffeau dressait sa façade prétentieuse parmi d’autres demeures non moins altières. Madame veuve Roberteau n’était pas une bigote confite en dévotion. Elle s’en défendait avec indignation. Elle se définissait elle-même, avec une satisfaction mal dissimulée, comme une femme à principes, et elle portait des jugements sévères et sans appel sur les gens qu’elle fréquentait, et qui ne respectaient pas le code de vie qui lui paraissait tout naturel. « Ils n’ont pas de colonne vertébrale ! Ce sont des gens sans honneur ! » assénait-elle alors sur un ton sans réplique.
Marion et Claude s’étaient retrouvés à Paris. Claude y était étudiant en dernière année à la faculté de Pharmacie, qui dresse sa noble façade près de l’Observatoire. Mais le jeune homme était doué d’une vive intelligence. Après avoir suivi une année de « prépa » en Math générales, il avait décidé de s’orienter vers la pharmacie avec, comme perspectives, la spécialité de Laboratoire d’analyses médicales, assez nouvelle à l’époque. Mais cela ne lui suffisait pas et, depuis peu, il avait simultanément commencé des études à la Faculté des Sciences, à la Sorbonne, distante d’une dizaine de minutes à pied. Il passait souvent par le jardin du Luxembourg pour y prendre l’air et se détendre.
C’est à la Sorbonne qu’il rencontra Marion Alluyes, venue à Paris quelques années plus tard pour y faire des études de chimie. Ils sympathisèrent car ils se connaissaient déjà un peu et tout contribuait à les rapprocher : leur ville natale, les relations qu’ils y avaient, et leur milieu social. Marion était dans tout l’éclat blond et la fraîcheur resplendissante de la jeunesse, et elle n’était pas insensible à la prestance et à l’assurance du jeune étudiant, dont elle tomba amoureuse sans même avoir eu le temps de s’en rendre compte. Il était bel homme. Sa chevelure châtain foncé était rejetée en arrière et dégageait un front haut. Il avait un visage aux traits réguliers, montrant souvent un sourire qu’elle trouvait charmant lorsqu’il la regardait de ses yeux bruns scrutateurs. Il l’invita à des promenades dans la capitale, qu’elle ne connaissait pas, et il lui en fit découvrir les monuments et les jardins. Il l’emmena à la tour Eiffel, aux jardins du Trocadéro, au Champ-de-Mars, aux Invalides. Une autre fois, ce fut l’environnement immédiat de la Sorbonne qui constitua le sujet de leur promenade : le Quartier latin, la rue Mouffetard si pittoresque, qui descend en pente douce depuis le sommet de la montagne Sainte-Geneviève.
Un autre jour, ils descendirent au bord de la Seine et visitèrent la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, la tour Saint-Jacques et Notre-Dame. Ils consacrèrent un après-midi pour faire une première reconnaissance du Louvre. Bien d’autres visites du musée suivirent.
Une expédition plus lointaine les entraîna jusqu’à Montmartre et au Sacré-Cœur. Marion adora la place du Tertre et erra avec curiosité parmi les peintres, regardant avec intérêt leurs tableaux.
« Tu perds ton temps, Marion. Ce sont des productions alimentaires pour les touristes !
– Sans doute. Mais je prends quand même plaisir à regarder ces toiles. Certaines me plaisent même carrément. »
Claude emmena plus tard Marion à l’Opéra pour y assister à une représentation de Don Giovanni. La jeune fille fut émue aux larmes par l’air complexe et difficile de la Reine de la Nuit, l’inoubliable « Der Hölle Rache » aux vocalises si merveilleuses mais si éprouvantes pour l’artiste. Mais Marion se souvenait aussi, plus de vingt ans après, des tentatives de Claude qui chercha à profiter des circonstances pour la caresser en public. Elle en fut chagrinée et lui en fit le reproche. Il avait vite flirté avec elle et l’avait embrassée. Elle se sentait très troublée lorsqu’il était là et devenait incapable de le repousser. Elle éprouvait sans se l’avouer un profond plaisir à ses étreintes. Il s’en était aperçu et profitait de la permission tacite qu’elle lui avait donnée. Mais elle avait un peu honte en public et refusait qu’il la câline, comme il disait en riant.
Leur relation se gâta le lendemain, lorsqu’il voulut aller encore plus loin et manifesta son intention de lui faire l’amour. Marion protesta et refusa sèchement. Croyant que la jeune fille faisait des manières avant de céder, et persuadé qu’elle éprouvait trop de plaisir à ses caresses pour lui opposer très longtemps un refus, Claude insista dans ses tentatives. Mais il s’était lourdement trompé. Elle n’avait pas du tout l’intention de devenir sa maîtresse. Il fut très surpris, puis lui manifesta son mécontentement.
— Marion, qu’est-ce que ça signifie ? Tu acceptes mes baisers, mes caresses, je deviens fou de désir, et, quand je veux passer à l’acte, persuadé que tu n’attends que ça et que tu le désires, toi aussi, tu dis stop ! On arrête tout ! Je ne croyais pas que tu étais une allumeuse ! Car tu ne peux pas me dire le contraire : mes baisers et mes caresses te plaisent ! Ose dire non !
Elle le regardait, avec de la souffrance sur son visage.
— Je suis désolée, Claude, si je t’ai laissé croire…cela. Ce n’était pas du tout mon intention, je t’assure ! Oui, pour répondre à ta question, j’ai moi aussi envie de toi. Je ne te l’ai pas caché. Mais je ne t’ai jamais dit que j’irais jusque-là, jusqu’à faire maintenant l’amour. Quand nous serons mariés, nous passerons la nuit à nous aimer. Car tu veux m’épouser, Claude ?
Devant l’air surpris du jeune homme, elle eut brusquement conscience du malentendu. Elle rougit, pâlit, balbutia :
— Non, Claude. Non. Je ne cherche pas à te piéger. Je ne suis pas une allumeuse. En aucune façon. C’est indigne, de laisser croire une telle chose et de se dérober, de jouer avec son partenaire. Je ne t’ai à aucun moment laissé croire que je me donnerais à toi, comme on dit dans les romans. Seulement, pour moi, une relation avec un homme que j’aime ne s’improvise pas au bord du chemin, ou du lit. Elle engage ma vie. Comment te dire ? Ma relation avec toi ne peut exister que dans la durée. Je ne l’envisage pas autrement. Pour moi, vois-tu, tu n’es pas une passade, un bon coup ; c’est bien comme ça qu’on dit ? Mais tu as le droit d’avoir une autre façon d’envisager ta vie.
Mais Claude avait le visage fermé. Il se détourna en murmurant : « une allumeuse… » et, saisissant sa veste, il s’en alla sans la regarder. Marion lui jeta, lorsqu’il ouvrait la porte : « Non, pas une allumeuse ! »
Ils ne se revirent plus pendant plusieurs semaines, sinon de loin, et sans se parler. Les camarades de Marion, qui connaissaient la relation qu’elle entretenait avec Claude, lui dirent avec embarras qu’on voyait le jeune homme avec d’autres filles. Marion pensa que s’en était fini avec lui. Ils s’étaient trompés tous deux : elle avait cru qu’il envisageait une relation sérieuse avec elle, alors que, en réalité, il ne l’aimait pas et n’avait en tête que d’en faire une énième maîtresse. Car les langues s’étaient déliées. Claude était un peu plus âgé qu’elle et il était depuis plus longtemps à Paris. Celles et ceux qui le connaissaient donc de plus longue date parlaient de lui comme d’un coureur de jupons, ce qu’elle ignorait jusque-là.
Or une fin d’après-midi, on sonna à la porte de l’appartement où elle avait loué une chambre. La propriétaire, une femme d’un certain âge, alla ouvrir, et elle entendit vaguement une brève conversation. On frappa ensuite à sa porte et elle entendit : « C’est pour vous. »
Elle ouvrit la porte et trouva sa propriétaire qui la regardait avec une lueur dans les yeux. Elle l’informa à mi-voix :
— C’est l’étudiant que vous fréquentez. Je l’ai fait entrer dans le salon. Je ne souhaite pas qu’il aille dans votre chambre ; c’est bien ce qui était convenu !
— Oui, bien sûr, madame. Merci.
La femme hocha la tête avec satisfaction. Marion se dirigea vers le salon et en poussa la porte. Claude, qui s’était assis, se leva précipitamment et se tourna vers elle.
« Marion, je suis une brute et un imbécile. Laisse-moi parler, s’il te plaît. Voilà. Je ne sais pas bien comment te dire… Je t’aime et je veux t’épouser, si tu veux bien pardonner à un mufle. »
Elle resta un instant interdite. Elle entendait une petite voix insistante qui lui chuchotait les mises en garde de ses camarades. Mais il était venu ! Il était là, devant elle, la mine contrite. Il voulait l’épouser ! Elle tendit les bras vers lui et se jeta dans ses bras en sanglotant à moitié.
Trois semaines plus tard, Claude fut invité à faire une visite chez madame et monsieur Alluyes, accompagné de sa propre mère. La demande en mariage fut, à cette occasion, cérémonieusement formulée et les deux jeunes gens se fiancèrent, à la grande satisfaction des deux familles. Il fut d’abord proposé que le mariage aurait seulement lieu une fois les études terminées, mais Claude et Marion se récrièrent et les deux mères battirent en retraite en maugréant un peu. M. Alluyes souriait d’un air complice. Le mariage eut donc lieu au début du mois de juillet suivant.
Après en avoir discuté, les amis de Marion préférèrent omettre de lui révéler les propos indécents que son Claude avait tenus, lors de soirées de carabins auxquels l’étudiant en pharmacie se joignait fréquemment. Il disait regretter d’avoir laissé tomber la donzelle, qui était - quand même ! - pourvue d’une dot conséquente, et de belles « espérances ». Les autres étudiants, aussi éméchés que lui, avaient lancé des plaisanteries moqueuses. « Si elle est mordue, tu peux la reconquérir et lui passer la bague au doigt ! Courage ! » Un autre avait observé avec un sourire carnassier : « Paris valait bien une messe, pour notre Vert-galant royal ! Un bel héritage aussi ! jeune galant. »
Claude avait des projets plein la tête. Ils tournaient autour de la création d’un laboratoire d’analyses médicales, quasi inexistants à l’époque. Il entretenait longuement sa jeune femme de la stratégie à mettre en place pour gagner très vite une fortune.
— Il faut au préalable acquérir une maison bien placée et assez grande pour y habiter, bien sûr, mon amour, et aussi pour y implanter les pièces nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire. Il faudra prévoir une petite salle d’attente, une salle de prélèvements, une salle dédiée aux analyses… et même un clapier dans le jardin pour y entretenir des lapines.
— Des lapines ? Pourquoi des lapines ?
— Mais pour les tests de grossesse ! Les femmes, désireuses de savoir si elles sont enceintes, donnent un peu d’urine. Les lapines permettent d’effectuer le test de Friedman. Je te résume : On injecte l’échantillon d’urine dans l’ovaire de la lapine. Trois jours après, si la lapine ovule, c’est que la femme est enceinte, puisque l’ovulation a été déclenchée par l’hormone de la grossesse, le HCG, dans l’urine de la cliente.
— Bon. J’ai compris. Tout ça, c’est bien beau. Mais nous n’avons pas un sou. Alors « adieu veau, vache, cochon, couvée ».
— Effectivement. Mais ne soit pas aussi découragée. Je réfléchis aux moyens de nous en procurer.
Le fils Roberteau découvrit, un jour qu’il était retourné à Blois, une maison à vendre qui correspondait en tous points à la maison idéale à laquelle il songeait. Elle était d’abord bien placée, dans le centre-ville, et dans une rue bourgeoise. Son architecture était élégante et la disposition des pièces, nombreuses, permettait d’avoir une zone professionnelle, en rez-de-chaussée, et un espace privé à l’étage. Un jardin mal entretenu s’étendait derrière la bâtisse, vidée depuis le décès de son vieux propriétaire. Mais le notaire, chargé de la vente par la succession, après qu’il eut annoncé le prix très conséquent de la propriété, sourit lorsque monsieur Roberteau junior lui annonça qu’il n’avait pour l’instant pas de liquidités pour payer la maison.
« Eh bien, cher monsieur, je comprends très bien votre projet, qui me paraît fort ambitieux mais aussi très réalisable, à condition d’avoir de la trésorerie. Malheureusement, puisque vos familles respectives ne sont pas prêtes à vous avancer les fonds, commencez par gagner de l’argent ; vous pourrez ensuite revenir me voir. »
C’était la fin de l’année universitaire à Paris. Claude Roberteau, qui avait terminé ses études de pharmacie, dévoila un nouveau plan à sa femme, qui avait elle-même fini sa licence de chimie : « Il nous faut un moyen de gagner rapidement de l’argent et je crois l’avoir trouvé. J’ai observé que, dans la région du Blésois, de nombreuses communes ne disposent pas de pharmacie. Je me suis renseigné sur les formalités à effectuer pour en créer. Il faut d’abord ne pas empiéter sur la zone d’influence de celles qui existent déjà. J’ai établi sur une carte la liste des possibilités au nord de Blois. Ayant maintenant le diplôme de pharmacien, je vais effectuer ma demande auprès des autorités compétentes, puis une fois que j’aurai leur accord, je louerai un local et nous installerons une nouvelle officine. Tu m’aideras au début et tu apprendras vite le BA BA du métier. Tu verras ! On gagnera vite de l’argent. Je devrai rejoindre Paris pour y continuer mes études à la fac des Sciences et en même temps effectuer mon internat pour devenir pharmacien-biologiste. Je le sais bien, tu n’as pas qualité pour tenir seule une pharmacie. Mais c’est un petit bourg auquel je pense, et les habitants seront trop heureux d’avoir une pharmacie pour venir te demander tes diplômes. Et, d’ailleurs, c’est moi qui serai le pharmacien en titre.
Marion n’était pas très enthousiaste à l’idée de contribuer à mettre en place ce qui s’apparentait à un exercice illégal de la pharmacie. Car, malgré les beaux discours de Claude, elle n’était pas habilitée pour délivrer des médicaments. Ses connaissances en chimie pouvaient l’aider mais il restait que, sur le plan administratif, elle serait dans l’illégalité. Néanmoins, par amour pour le beau Claude, elle se retrouva assez vite derrière le comptoir d’une officine, créée dans le petit bourg de Savenne, non loin de Blois, pour le plus grand bonheur des habitants.
Son mari se trouvait la plupart du temps à Paris, où il se partageait entre son poste d’interne en pharmacie, dans un hôpital, et la poursuite de ses études en Sciences physiques. Il trouva aussi le temps de frayer avec une splendide et sculpturale blonde, Brigitte Faurey, avec laquelle il entretint des amours tumultueuses. Il appréciait ses nombreux charmes mais n’éprouvait pas pour elle les sentiments dont elle brûlait pour lui. Cela la rendit imprévoyante et, un jour, elle découvrit avec angoisse qu’elle était enceinte. Claude ne lui avait pas caché qu’il était marié et il n’était pas envisageable qu’il divorce. Heureusement, son esprit inventif repéra qu’un autre homme semblait tourner autour de la belle blonde qui ressemblait à Marylin Monroe. C’était un étudiant en mathématiques, grand, un peu voûté, et qui semblait vivre sur un nuage. Il s’appelait Jean-François Bleizy, mais, très vite, les autres étudiants l’avaient surnommé « professeur Tournesol ». Brigitte eut un petit sourire et avoua à Claude que Tournesol en pinçait en effet pour elle mais qu’il était fort timide.
« Eh bien, voilà la solution à tous nos problèmes ! Tu forces un peu la main à ton soupirant, tu le conduis très vite au lit et tu lui annonces dans un délai raisonnable qu’il est l’heureux père de ta progéniture ! Bien sûr, il se doit, s’il est un homme d’honneur, de te passer bien vite la bague au doigt et de faire de toi une femme respectable. »
La jeune femme le regarda avec une expression ahurie.
« Quoi ? Tu veux que je couche avec Bleizy … Et que je l’épouse ? C’est toi qui me dis ça ?
— Si tu vois une autre manière de sortir du dilemme, tu me l’indiques. Allons, Brigitte, c’est un gentil garçon, très intelligent et fort doux, pour autant que j’aie pu en juger. Il fera un très bon père nourricier et il t’adore, tu le reconnais toi-même. Cela ne nous empêchera pas de nous voir et de prendre du bon temps, comme avant !
— Quel cynisme, mon garçon ! Je ne te connaissais pas sous cet angle. Tu ne gagnes pas à être connu, Claude.
— Je suis un être rationnel. Seulement un être rationnel. Cela n’exclut pas le sentiment et tu sais bien que je t’adore, ma chérie.
Elle regardait avec curiosité et perplexité ce beau garçon aux pétillants yeux marron, tout sourire. C’était vrai qu’il lui plaisait bien et elle s’avoua même qu’elle en était malheureusement et définitivement tombée amoureuse. Quelle idiote ! Tomber amoureuse d’un homme marié ! Elle reconnut que ce monstre n’avait peut-être pas tort et que, si elle acceptait les hommages de ce Tournesol dégingandé, mais à l’esprit fin, elle pouvait résoudre d’un coup ses problèmes. Il était thésard et envisageait avec confiance de prendre un poste à l’Université.
Les mois passèrent. Claude assista au mariage de Brigitte et Jean-François. La jeune femme s’arrondit assez rapidement et les étudiants félicitèrent chaudement son Tournesol de mari pour la vigueur de sa virilité, ce qui le plongea dans un certain embarras, mais ne lui déplut pas non plus. Ses parents étaient très heureux de cette union et avaient mis la main au portefeuille pour donner aux jeunes mariés une location mieux adaptée à la survenue d’un premier enfant.
Tout s’était bien passé aussi pour Marion, mais les pharmaciens qui exerçaient dans des communes voisines avaient vu baisser leur chiffre d’affaires. Ils avaient commencé à s’intéresser de plus près à cette nouvelle officine qui leur taillait des croupières. Ils avaient cherché à nouer des relations avec le pharmacien nouveau-venu et avaient découvert qu’il n’était guère dans sa boutique. Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens en avait été saisi, au niveau départemental, et avait envoyé une convocation à Claude Roberteau. Celui-ci avait eu recours dans un premier temps à des subterfuges pour retarder la rencontre. À bout de patience, le représentant départemental avait décidé de se déplacer sans autre préavis, pour constater la non-conformité de cette nouvelle création d’officine. Mais les Roberteau avaient le bras long et Claude avait été averti la veille par téléphone de cette descente.
Lorsque l’inspecteur débarqua, il trouve le pharmacien à son poste en blouse blanche, fort occupé à expliquer la posologie des médicaments délivrés sur ordonnance à un patient. Il attendit la sortie du client et se présenta à Claude Roberteau, en lui expliquant la raison de sa venue. Ce dernier ne fit qu’en rire.
« Oui, c’est vrai, cher monsieur. Je ne suis pas là tous les jours, je veux bien le confesser, mais vous pouvez constater par vous-même qu’on vous a fait un rapport mensonger. Car enfin, je suis là, n’est-ce-pas ? Quand je m’absente, ma femme ouvre la boutique et sert les clients. Lorsqu’il se présente un cas un peu embarrassant, elle le met de côté et m’en parle quand je reviens. Et dites-moi, monsieur. Je suis fondé à croire que vous venez sur plainte des confrères voisins. Qui n’apprécient peut-être pas mon installation dans cette commune, non ? Mais alors, peut-être pourrais-je à mon tour me plaindre auprès de vous de l’absence périodique de mon confrère le plus proche, qui disparaît en période de chasse dans les brumes de la Sologne profonde ? Ou encore de celle de cet autre excellent confrère, féru de navigation lointaine, et qui laisse son officine en jachère pendant tout un mois, confiant dans les lumières de son préparateur ? Vous voyez de qui je veux parler ?
— Hum ! Il ne faut pas nous emballer, mon cher confrère. Vous n’avez pas tort dans le fond mais je ne peux pas, et vous le comprendrez, vous tenir au courant des procédures en cours contre tel ou tel. Restons dans le cas qui nous occupe : le vôtre. Je peux comprendre que vous ayez une difficulté passagère à assurer une présence permanente dans votre officine. Mais je vous rappelle néanmoins que c’est votre officine, et que votre présence continue y est requise de façon règlementaire. Cela est bien entendu ? Je vous donne quelque temps pour régulariser votre situation, mais vous comprenez bien que je ne pourrais pas fermer les yeux très longtemps. »
Roberteau avait très bien compris. Il passa ses derniers examens à la faculté de pharmacie et à la Sorbonne. Il vendit son officine pour une somme rondelette et retourna voir le notaire pour acheter la maison qu’il avait lorgnée dans le centre de Blois, en espérant qu’elle serait toujours en vente. Les familles Roberteau et Alluyes avaient pris acte des efforts de leurs enfants et promis d’abonder le budget, pour compléter la somme requise. Claude eut une divine surprise : les propriétaires de la maison, qui en avaient hérité, ne trouvant pas d’acheteur avaient consenti à baisser le prix demandé de façon substantielle. Claude Roberteau déclara au notaire qu’il était toujours acheteur, mais souhaitait cependant un dernier petit rabais, qui lui fut accordé par des propriétaires soulagés de vendre enfin, et de se partager la succession.
C’est ainsi que les deux jeunes époux finirent par entrer dans cette grande et belle maison, sise dans une rue bourgeoise et fréquentée, et que Claude Roberteau put réaliser son rêve d’un laboratoire d’analyses médicales, qui fit très vite d’excellentes affaires.
Chapitre 3 - Une soirée libertine
Claude était préoccupé. Il aurait voulu un héritier mais sa femme ne pouvait lui en donner un. Il savait que le problème ne venait pas de lui, puisque Brigitte, sa maîtresse, avait conçu de ses œuvres, selon la formule consacrée, un très beau bébé. La difficulté venait donc de sa femme. Les années précédentes, ils avaient tous deux pris des précautions pour que leurs rapports conjugaux ne conduisent pas à une grossesse non désirée ; ils avaient tellement d’autres problèmes à résoudre ! Ce n’était pas le moment de se compliquer l’existence avec un petit être vagissant qui leur mangerait leur temps et toute leur énergie ! Mais maintenant Claude voulait que leur couple ait un enfant. Pourquoi cette lubie ? Il n’aurait pas su l’expliquer très clairement. Il avait eu l’occasion de retrouver Brigitte et son mari, le lunatique Bleizy, et il avait regardé avec un étrange sentiment d’envie et de jalousie leur petit garçon, dont il était le père, en fait.
Pourquoi donc Marion était-elle incapable de procréer, comme Brigitte ? Évidemment, il connaissait les examens pratiqués pour déterminer la cause de la stérilité féminine : bilan hormonal, hystéroscopie, échographie de l’utérus et des ovaires, caryotype etc. En tant que pharmacien biologiste, il avait les connaissances nécessaires dans ce domaine, même s’il n’était pas médecin. Mais, avant de lancer les recherches dans le domaine scientifique, il avait en tête une approche plus empirique. Ses conversations avec des médecins de Blois lui avaient appris que des femmes mariées, incapables de concevoir, tombaient enceintes, sans explication satisfaisante sur le plan scientifique, pour la simple raison que leur sœur, qui venait de se marier, était devenue grosse. On peut essayer de formuler une explication comportementale, proposaient avec hésitation ces éminents praticiens : le spectacle de la sœur enceinte lève une barrière psychologique, met en œuvre un processus physiologique, active une glande qui ne fonctionnait pas bien avant et qui libère une hormone indispensable à la reproduction. Un autre médecin approuvait et ajoutait : « les mécanismes de la reproduction sont d’une infinie délicatesse. Ils mettent en œuvre des éléments purement physiologiques, bien sûr, mais aussi nécessitent des facteurs psychologiques dont on mesure mal l’importance. La science a ses limites. »
Claude conclut, après avoir longuement réfléchi, que sa femme devait être la victime d’un blocage. Il envisagea les moyens à mettre en œuvre pour le supprimer. Il avait entendu parler d’un endroit qu’on n’évoquait qu’à mots couverts : la Retirais. C’était un ancien pavillon de chasse construit au temps de François 1er à l’orée de la forêt de Blois. Il appartenait actuellement à un industriel blésois qui y avait installé un club privé. Claude mit un peu de temps à connaître plus précisément les activités de ce club, fréquenté en fait par des échangistes. On n’en parlait qu’à mots couverts. On ne pouvait y entrer que par cooptation mais il fallait cependant payer une carte. Et il apprit aussi que les consommations n’étaient pas données.
Marion n’accueillit pas très bien sa suggestion d’y passer une soirée.
« Non mais, Claude, te rends-tu compte de ce que tu me dis ? Tu ne serais pas hostile à l’idée que je m’envoie en l’air avec n’importe quel type qui fréquente ce mauvais lieu ? C’est bien ce que tu proposes ? Car, si j’ai bien compris, c’est quand même bien le but du jeu ? Cela ne te rend pas jaloux ?
— Mais, Marion, tout ce que je veux, je te le répète, c’est seulement faire sauter le verrou psychologique qui, j’en suis persuadé, t’empêche de concevoir. Je te concède que la perspective de te savoir avec un autre homme ne m’emballe pas plus que ça, mais si cela peut t’aider à avoir un enfant…
— Ah ! Quand même. Ça ne t’emballe pas plus que ça… Ça fait plaisir à entendre. Et toi ? Tu vas draguer l’une de ces bonnes femmes qui fréquentent ce lieu de perdition ?
— Mais non, voyons ! C’est pour toi, uniquement pour toi, que je fais ça. Allons ! On pourrait au moins aller voir à quoi ça ressemble. Cela ne t’oblige en rien. Tu y boiras avec moi une coupe de champagne, et nous rentrerons, si ça ne te tente pas. J’aurai au moins essayé quelque chose pour t’aider.
— Trop aimable ! C’est d’accord. Après tout, je suis aussi un peu curieuse de voir à quoi ça ressemble. L’expérience peut être intéresssante. »
Ils prirent place à bord de l’énorme voiture américaine – une Buick Roadmaster –que Claude avait achetée d’occasion. Il était un grand amateur de ces vaisseaux sur roues bardés de chrome, tanguant sur leurs gros amortisseurs, au moteur V8 d’une cylindrée de six litres, grondant comme un fauve, et qui transmettait son énorme puissance aux roues arrière par l’intermédiaire d’une boite de vitesses automatique. Ils quittèrent le centre-ville à la nuit tombante et montèrent vers le quartier nord. Après quelques kilomètres à travers une campagne envahie par la brume du soir, ils quittèrent la grand-route et tournèrent à gauche dans une petite route qui menait à la forêt. Les immenses champs de céréales avaient laissé la place à des prairies entourées de talus et de haies vives. Claude surveillait les pancartes qui apparaissaient de loin en loin dans la pénombre. Soudain il freina et stoppa son véhicule pour déchiffrer une pancarte que ses phares éclairaient mal.
« Nous y sommes ! C’est le chemin de La Retirais. Il y a une zone de stationnement au bout du chemin. »
Le chemin était un peu défoncé et la Buick tanguait comme un bateau sur la houle de la mer, les phares balayant les cailloux du chemin puis la cime des petits arbres qui poussaient sur les talus. Ils arrivèrent enfin sur un terre-plein où une quinzaine de véhicules étaient rangés. Derrière, une prairie obscure s’étendait, et ils virent tout au fond la silhouette d’une grande demeure, dont la toiture très élancée se détachait sur le ciel clair piqueté d’étoiles. Les fenêtres diffusaient sur le parc une lueur assourdie. Ils quittèrent la Buick et prirent l’allée qui conduisait au manoir. Le hall d’entrée était brillamment éclairé et ils furent un peu aveuglés, au sortir de la nuit, par les lustres qui dispensaient une lumière vive. Un majordome impassible leur souhaita le bonsoir et tendit la main en disant : « je souhaiterais voir votre carte d’invitation, s’il vous plaît. »
Puis ils furent invités à laisser leur manteau au vestiaire et le majordome poussa enfin une grande porte donnant sur le salon. C’était un vaste espace éclairé de façon confidentielle par quelques lampes sur des petites tables basses, que des fauteuils confortables entouraient. Un bar occupait tout un côté de la pièce. Une serveuse strictement habillée y officiait. Elle les regarda entrer avec indifférence. Quelques personnes d’apparence bourgeoise, correctement vêtues, étaient assises. Elles formaient trois groupes de consommateurs. L’atmosphère était feutrée et paisible. On entendait la musique en sourdine, qui se mêlait au murmure confus des voix. Marion avait été pleine d’appréhension sur la route. Elle s’attendait à voir une serveuse en tenue affriolante, et des invités braillant dans une délirante bacchanale. Elle éprouva un grand soulagement en observant qu’il n’en était rien. Claude avait convenu avec elle qu’ils ne chercheraient pas à rester ensemble. Il souhaitait qu’elle découvre par elle-même ce que proposait ce club libertin. À peine arrivé, il fut hélé par deux hommes qui le connaissaient, et qui se levèrent de leur fauteuil de cuir pour lui serrer la main. Ils saluèrent de la tête Marion, qui leur sourit puis qui se dirigea vers le bar, sans plus s’occuper de son mari. Elle demanda à la serveuse une coupe de champagne, et s’installa sur un haut tabouret en se tournant à moitié pour observer la salle. Claude et ses deux compagnons, après quelques minutes passées à bavarder, partirent en direction de la pièce voisine. Deux autres consommateurs étaient accoudés au bar. Celui qui se trouvait non loin d’elle venait également de demander une coupe. Il se tourna vers Marion et lui demanda la permission de se rapprocher pour bavarder. Elle n’y vit pas d’inconvénient et lui sourit pour lui signifier son accord.
La musique douce, en mode mineur, dominée par la clarinette de Sydney Bechet, la berçait dans une sorte de mélopée langoureuse. Elle avait d’abord entendu la si longue et triste phrase de Summertime, modulée sur le lent tempo de la contrebasse et de la batterie ; puis avaient succédé l’inoubliable Petite Fleur et Blues in my heart. Elle se sentait inexplicablement triste – la faute à Sydney Bechet – mais aussi qu’était-elle venue faire dans cette galère ? Elle espéra que son voisin allait la tirer de son spleen.
C’était un homme jeune, vêtu avec une discrète élégance. Lorsqu’il vint se percher sur le tabouret voisin du sien, en tenant à la main sa coupe pleine, elle sentit son parfum, légèrement boisé. Il avait une chevelure brune, coupée en brosse courte. Il offrait d’abord une impression d’énergie et de virilité, démentie par des traits un peu empâtés et un regard vacillant. Il engagea la conversation avec elle, sur des thèmes généraux d’une grande banalité.
Elle était sur ses gardes mais se sentait un peu ridicule. Rien dans ce club ne déclenchait dans sa tête la moindre alarme, et encore moins cet homme bien mis et d’une courtoisie impeccable. Sa vertu n’était vraiment pas en danger ! Il se montra tout d’un coup galant, mais d’une façon exquise. Il la regardait attentivement et se mit à sourire. Elle lui demanda ce qu’il avait en tête.
« Si je vous le dis, vous me promettez de ne pas vous moquer de moi ! Voilà, les lumières sont tamisées, et cette lampe vous éclaire de telle façon que je vous trouve une ressemblance avec des modèles de Georges de La Tour, un peintre renommé pour ses clairs-obscurs qui sculptent le visage de ses personnages. Vous êtes blonde, vous avez une carnation de pêche, et l’éclairage vous rend tout simplement divine ! Eh bien, vous voyez que vous riez de moi ! »
En effet, Marion ne s’attendait pas à un si agréable compliment, et elle riait pour masquer sa confusion. Ses yeux furent alors attirés par l’autre homme accoudé au bar, un peu plus loin, devant une coupe pleine. Elle l’enveloppa du regard en un instant avec étonnement. L’éclairage si particulier de la salle accentuait vigoureusement les ombres de son visage allongé, soulignant un long nez busqué. La lampe faisait en quelque sorte rayonner ses traits. Il avait la tête un peu penchée et il la fixait avec une intensité presque gênante. Ses yeux étaient grands ouverts, surmontés de longs sourcils, qui remontaient étrangement vers les tempes, et un vague sourire moqueur errait sur ses lèvres.
Un peu confuse, elle détourna le regard vers son voisin, qui n’avait pas pris conscience de sa distraction. Tout en continuant à bavarder légèrement avec lui, elle cherchait dans ses souvenirs ce qui avait éveillé si fort sa curiosité lorsqu’elle regardait l’autre homme. Et tout à coup, une scène lui revint. C’était, au temps de ses études parisiennes, lors d’une soirée à l’Opéra. On y jouait le Faust de Gounod, avec Cesare Siepi comme interprète de Méphistophélès. Elle se souvenait aussi des discussions oiseuses de leurs amis qui se disputaient pour savoir si Siepi était une basse ou une basse-baryton. D’autres ne juraient que par Chaliapine, autre interprète célèbre. Rien de plus barbant que ces discussions byzantines entre initiés passionnés, ergotant sur la tessiture et la couleur de la voix ! Elle se souvenait surtout de la Sérénade de Méphistophélès et de l’envoûtement de cette voix splendide, si sarcastique envers Marguerite. Or le buveur solitaire au bout du bar ressemblait étrangement à l’interprète diabolique du sardonique « Vous qui faites l’endormie, n'entendez-vous pas ma voix et mes pas ? N'ouvre la porte, ma belle, que la bague au doigt. Pourquoi refuser, à l'amant qui vous implore, pourquoi refuser un si doux baiser ? ». Elle avait été charmée par la beauté de Cesare Siepi, et subjuguée par le velouté de sa voix. Elle était bizarrement sensible, maintenant, au charme sombre de cet inconnu du club, qui le lui rappelait tant.
Celui-ci se redressa, saisit d’une main sa coupe et de l’autre le tabouret, et il vint familièrement, et avec autorité, s’interposer entre Marion et son voisin.
« Bonsoir ! Vous voudrez bien m’accepter dans votre petit groupe car je me sens seul, et je trouve l’atmosphère bien pesante, ce soir, au club ! Je me présente : Ferri, Lucio Ferri.
— Marion Roberteau. Bonsoir monsieur Ferri.
— Je vous connais, monsieur Duponchel. Le célèbre tailleur Duponchel ! Vous tenez aussi le magasin de prêt à porter, de l’autre côté de la Loire, dans le quartier rive gauche, le quartier de Vienne.
–– Mais moi aussi je vous connais, monsieur Ferri. Vous êtes le propriétaire d’un casse, à la sortie nord de Blois.
— Eh bien voilà ! La glace est rompue ! Oh ! Vous avez des coupes comme la mienne. Permettez que je dépose ma coupe sur le bar. Trois coupes. Ça me fait penser à un jeu, le bonneteau.
— Un jeu interdit parce que c’est le prétexte à des escroqueries !
Le tailleur protestait d’une voix indignée.
— Mais il n’est pas question de jouer de l’argent, je vous rassure. C’est simplement pour distraire la dame. Et pour nous amuser aussi, bien sûr ! Regardez : nous avons trois coupes. Repérez bien la vôtre. Celle de Marion – vous permettez que je vous appelle Marion ? – est à gauche, la mienne au centre, et celle de Duponchel à droite. Je vais rapidement les intervertir et vous allez dire où s’est promenée votre coupe. Attention ! C’est parti ! »
Le bel homme à profil méphistophélique promena les coupes, en riant aux éclats, les intervertissant prestement. Puis il retira les mains.
« Alors ? »
Ils montrèrent chacun leur coupe avec un sourire triomphant.
« Gagné ! Mais c’était un tour de chauffe. Maintenant je vais passer la vitesse supérieure ! »
Et tout en parlant il fit virevolter les coupes pendant quelques secondes. Lorsqu’il arrêta, Marion n’était pas du tout sûre d’avoir bien suivi sa coupe dans sa danse sur le bar. L’air perplexe du tailleur trahissait sa propre ignorance.
« Et vous savez, Ferri, où vous en êtes vous-même ?
— Bien sûr ! C’est la première leçon de l’apprentissage d’un bon meneur de jeu. Quand on joue pour de l’argent, une chose bien vilaine, mais si excitante, Duponchel, hein, il est essentiel de savoir où se trouve la bonne carte quand on joue avec trois cartes – dans mon pays d’origine, l’Italie, on parle du gioco delle tre carte – ou encore le dé sous le gobelet dans l’autre cas.
— Eh bien, où se trouve ma coupe ? Ça m’a donné soif ? »
Méphistophélès désigna une coupe du doigt, avec un sourire railleur. Puis il se tourna vers la jeune femme, sur sa gauche, lui fit un clin d’œil de connivence et lui proposa de danser un peu. Elle accepta et ils se dirigèrent au milieu de la pièce, plus vivement éclairé, où un couple évoluait déjà. Marion n’était pas une danseuse expérimentée mais elle s’adapta vite à son partenaire, qui semblait très à l’aise. La serveuse du bar avait un peu augmenté le volume de la musique, pour inciter d’autres clients à rejoindre les deux couples.
« Savez-vous, ô belle Marion, pourquoi je me suis livré à ce petit jeu du bonneteau ?
— Pour nous distraire, disiez-vous ? Et veuillez éviter les flatteries superflues.
–– Pour nous distraire, sans doute. Mais j’avais aussi une excellente raison. De l’endroit où je me trouvais assis, j’avais vu que votre interlocuteur, le sieur tailleur, se disposait à glisser dans votre coupe un produit d’origine douteuse. J’ai entendu par le passé des appréciations peu élogieuses sur Duponchel, qui aurait drogué des femmes rencontrées dans des bars. Vous devinez à quelles fins, qu’un galant homme ne précisera pas…
— L’horrible bonhomme ! Et alors ? Il a versé sa mixture dans ma coupe ? Je n’ai rien vu.
— En général, c’est le but de la manœuvre ! Vous boiriez la coupe si vous soupçonniez qu’on l’a droguée ? Oui, je l’ai vu verser quelque chose dans votre coupe lorsque vous avez pivoté sur le tabouret pour regarder dans le fond de la salle.
— Il m’avait dit qu’il avait cru voir mon mari s’asseoir avec quelqu’un d’autre.
— Une simple diversion. Car votre mari n’était pas revenu, sans doute ?
— Non. Et je n’ai rien vu… »
Elle avait cessé de danser et s’était écartée de Ferri. Elle se retourna et regardait avec crainte et colère le gentil voisin, bien habillé, qui était encore assis au bar. Elle fit face à son cavalier, les sourcils froncés, et le dévisagea un instant, avant de se mettre à sourire.
« Mais j’y pense, quelle coupe a-t-il bu ?
–– Le destin est intervenu, je n’ose dire la Providence, étant qui je suis : votre coupe, celle qui était sophistiquée, comme on disait dans le vieux temps. Je ne sais pas ce qu’il y a mis, mais notre tailleur devrait aller de moins en moins bien, à mesure que sa drogue agira. »
Elle éclata d’un rire nerveux. Elle examinait de près le visage de Ferri. Il semblait avoir délibérément accentué sa ressemblance avec le Méphistophélès du Faust en portant un collier de barbe noire, qui allongeait encore son maigre visage. Et pourquoi cette remarque sibylline : « qui je suis » ? Il soutenait son regard en souriant, lui aussi.
« Vous semblez ne le pas comprendre, ma chère, mais mon nom est Lucifer ! »
Elle sursauta et rougit violemment.
« Comment… comment pouvez-vous connaître mes pensées ?
— Mais tout simplement parce que je suis Lucifer, celui qui porte la lumière. Lucio Ferri, en latin lucis ferre ! Nous sommes comme ça, nous autres, bons petits diables. Méphistophélès. »
Elle balbutia, l’esprit en déroute : « Arrêtez de plaisanter. Je n’ai pas le cœur à ça, en ce moment.
— Oui, je sais. Vous n’êtes pas partante pour l’échangisme. Mais votre tendre époux, lui, avait grande envie de tenter l’échange, et il s’y emploie fougueusement en ce moment. Libre à vous d’en faire autant.
— Quoi ? Il…
— C’est bien pour ça qu’il est venu, non ?
— Et pourquoi vous êtes-vous interposé pour m’éviter de boire cette coupe frelatée ?
— Oh ! Pas par compassion ni par humanité. Quels drôles de mots – Il gloussa – Je calcule que vous me serez beaucoup plus utile plus tard. Ah ! Ah ! Ah ! »
Elle l’examina avec frayeur. Allons, elle n’allait pas tomber dans le panneau ! Il jouait avec son nom, il jouait avec son apparence physique, il cherchait à la manipuler, comme il l’avait fait avec le bonneteau, et comme il essayait de le faire avec ses annonces de débauche ; comme si Claude allait copuler avec une femme inconnue ! Mais en même temps qu’elle formulait cette pensée dans son esprit, elle sut d’une façon aveuglante que son mari n’était venu que pour ça. Elle releva les yeux sur Ferri. Il la regardait, les yeux reflétant la lueur des lampes, un rire muet sur les lèvres, l’air sardonique.
« Alors, la petite dame, convaincue ? Vous ne voulez pas lui rendre la monnaie de sa pièce ? Je suis tout prêt à payer de ma personne. Même les diables sont de bons amants. »
Ce fut à ce moment-là que Claude revint dans le grand salon, et elle se précipita vers lui.
« Allons-nous-en, chéri ! Je t’en supplie, allons-nous-en. »
Chapitre 4 - Disputes conjugales
Claude ne posa pas de question Ă sa femme tant quâils traversĂšrent la grande prairie obscure, devant le manoir. Ils rejoignirent leur automobile et Claude ouvrit la portiĂšre pour permettre Ă Marion de sâinstaller. Puis il fit le tour de la Buick et sâinstalla Ă son tour au volant. Il se tourna alors vers elle. La lampe de lâhabitacle les Ă©clairait faiblement.
« Marion chérie, il y a eu un problÚme ?
â Oh oui, il y a eu un problĂšme, et je nâai guĂšre envie dâen parler. Mais je voudrais dâabord une rĂ©ponse Ă cette question : As-tu pris du bon temps avec les femmes qui Ă©taient lĂ -bas ?
â Tu mâas bien vu partir avec deux personnes, deux hommes que je connais, Marion. Non ? »
Elle était tournée vers lui mais distinguait mal son expression.
« Vous ĂȘtes passĂ©s dans quelle piĂšce ?
â Une salle-Ă -manger.
â Il y a dâautres piĂšces au rez-de-chaussĂ©e ?
â Je suppose que oui.
â Et Ă lâĂ©tage ? Jâai vu, quand nous Ă©tions dans la prairie, en arrivant, quâil y avait un Ă©tage, et que des fenĂȘtres Ă©taient Ă©clairĂ©es ?
â Mais enfin, Ă quoi riment ces questions ? Câest un club Ă©changiste, je ne te lâai pas cachĂ©. Je suppose donc que des alcĂŽves ont Ă©tĂ© disposĂ©es pour y accueillir les couples. Mais je nâai pas vĂ©rifiĂ©, et je nây suis pas allĂ© avec une partenaire, puisque câest lĂ ta question.
â Et vous Ă©tiez oĂč, avec ces deux hommes ? »
Il eut un profond soupir et grommela, puis jeta ensuite sur un ton excédé :
« Nous sommes sortis dans le parc, derriĂšre, et nous avons fumĂ© un cigare, en allant et venant ! Ce sont des entrepreneurs blĂ©sois. Nous avons discutĂ© dâun chantier Ă©ventuel. Jâai pensĂ© dĂ©molir le vieux hangar, qui est contre notre maison, et construire Ă la place un bĂątiment dans lequel on pourrait implanter un laboratoire de grande capacitĂ©, avec les structures habituelles, mais en plus une salle technique, qui recevrait des automates de cytologie, chimie, bactĂ©riologie etc. Ces appareils pourraient effectuer automatiquement de multiples manipulations et mesures, de façon trĂšs contrĂŽlĂ©e et trĂšs rapidement, pour un prix de revient bien moindre. Mais je nâai pas Ă©voquĂ© cette destination, seulement le coĂ»t dâune telle construction. Je ne tâen ai pas parlĂ© auparavant parce que je voulais te faire la surprise. »
Elle se rapprocha un peu de lui. Effectivement, elle dĂ©tectait une odeur de tabac. Mais elle percevait aussi, de façon plus diffuse, Ă©manant de lui, la fragrance dâun parfum de femme, qui nâĂ©tait certainement pas le sien. Sur un fond qui rappelait vaguement la violette, elle humait une note pĂ©tillante et florale, quâelle associa Ă Shalimar. Elle se souvenait bien de ce parfum capiteux, qui comptait aussi la bergamote, ainsi que la douce et pĂ©nĂ©trante vanille dans ses composants. Lâiris, et non la violette, se corrigea-t-elle.
« Tu tâes parfumĂ© avec du Shalimar ? »
Il ne rĂ©pondit pas mais souffla bruyamment par le nez. Il se pencha et mit en route le gros V8, alluma les phares, et dĂ©plaça le levier de vitesse de la position Park Ă celle de Drive. Le gros vaisseau sâĂ©branla doucement sous la poussĂ©e des quelque trois cents chevaux. Ils reprirent le chemin cahoteux dans lequel ils tanguĂšrent Ă nouveau, les pinceaux jaunes des phares tressautant sans arrĂȘt. Ils retrouvĂšrent la petite route qui luisait faiblement sous la lune, et revinrent trĂšs vite Ă Blois par la route de VendĂŽme.
Une fois la porte de la maison refermée, Claude se tourna vers sa femme. Il souriait mais ses yeux étaient hostiles. Il lui dit :
« Mettons les choses au point, Marion. Nous sommes allĂ©s, sur ma proposition et avec ton accord, dans un club libertin, avec lâespoir de dĂ©bloquer une quelconque barriĂšre psychologique qui tâempĂȘcherait de concevoir. CâĂ©tait sans doute une mauvaise idĂ©e, je te lâaccorde, et mĂȘme une trĂšs mauvaise idĂ©e. Je nâai jamais dit que ce club Ă©tait un patronage. Je tâavais donnĂ© carte blanche, si tu rencontrais un homme qui te plaisait, pour le suivre dans une alcĂŽve. La rĂ©ciproque Ă©tait vraie aussi, pour moi. AprĂšs tout, câest le principe de lâĂ©changisme. Je ne te questionnerai pas afin de savoir si tu as forniquĂ© ou non ; je te demande, pour moi aussi, la rĂ©ciproque. Maintenant, je suis fatiguĂ© par une journĂ©e qui a Ă©tĂ© bien chargĂ©e, et je vais me coucher. Je dormirai dans la chambre dâami. Bonsoir. Dors bien !
Quel mufle ! Comment pouvait-il escamoter avec cette insouciance, les Ă©vĂ©nements de cette soirĂ©e ? Ils ne revinrent pas dessus. Elle fut dĂ©finitivement rayĂ©e de tout Ă©change. Marion Ă©tait persuadĂ©e que son mari sâĂ©tait envoyĂ© en lâair dans ce club de la perdition, perdu dans la forĂȘt, au bout dâune improbable allĂ©e. Mais elle culpabilisait un peu en reconnaissant quâelle avait acceptĂ© â Ă contrecĆur, mais acceptĂ© quand mĂȘme â de se rendre avec lui Ă La Retirais. Elle pensait de temps en temps, avec malaise, Ă la rencontre avec Lucio Ferri. Quel Ă©trange personnage ! Elle lui Ă©tait redevable de lui avoir Ă©pargnĂ© dâĂȘtre droguĂ©e, si tant est que sa coupe eĂ»t Ă©tĂ© rĂ©ellement droguĂ©e. Comment sâĂ©tait-il exprimĂ© ? « SophistiquĂ©e », pas droguĂ©e. Elle fit une recherche et constata dans le Robert que le mot existait bien avec cette acception de frelatĂ©, mais que câĂ©tait un sens vieilli. Lucifer existe, il est vrai, depuis bien longtemps ! se moqua-t-elle intĂ©rieurement. Lâune des derniĂšres reparties du pseudo MĂ©phistophĂ©lĂšs la laissait fort mal Ă lâaise : « vous me serez plus utile plus tard ». Elle lui donnait lâimpression que les ĂȘtres humains nâĂ©taient que des pions dans le jeu de Lucio Ferri, comme si cet Ă©nigmatique personnage Ă©tait vraiment Lucifer ! Effrayant ! Allons, ma fille, oublie-le et passe Ă autre chose.
Lâoccasion lui en fut offerte par Claude â merci, mon chĂ©ri â, qui relança son projet de dĂ©veloppement du laboratoire. Mais il avait besoin de trĂ©sorerie pour dĂ©velopper cette extension de son entreprise. Il contacta un autre pharmacien biologiste, qui avait crĂ©Ă© lui aussi son laboratoire dans une ville voisine, et qui avait manifestĂ©, au cours dâune rĂ©union, son intention de vendre, puis de crĂ©er une autre unitĂ© dâanalyse ailleurs. Ce confrĂšre accepta de fonder une sociĂ©tĂ© avec Claude Roberteau, et dâapporter ses capitaux. Les mois passĂšrent et le projet prit corps. Une entreprise du bĂątiment arriva dans la rue, et lâancienne bĂątisse qui sâappuyait contre la belle maison des Roberteau fut rasĂ©e, les dĂ©blais enlevĂ©s. De nouvelles fondations furent coulĂ©es, sur lesquelles des murs de parpaing montĂšrent rapidement. Lâagencement intĂ©rieur fut menĂ© dans un temps record. Le laboratoire â en particulier dans sa partie technique â satisfaisait Ă toutes les exigences lĂ©gales, et plus encore, avec des extracteurs dâair et toute une panoplie de filtres qui purifiaient lâair. Ă lâĂ©poque de la construction, ce souci de lâhygiĂšne poussĂ© Ă ce degrĂ© Ă©tait exceptionnel ; il est devenu une rĂšgle courante maintenant. Des automates furent installĂ©s et du personnel fut engagĂ© : secrĂ©taires Ă lâaccueil, infirmiers et infirmiĂšres pour effectuer les prĂ©lĂšvements, laborantins pour manipuler ces prĂ©lĂšvements, et techniciens pour maintenir en bon Ă©tat tout le matĂ©riel ultra-moderne qui avait Ă©tĂ© installĂ©. Le chiffre dâaffaires sâenvola dĂšs la premiĂšre annĂ©e.
Les deux directeurs associĂ©s avaient effectuĂ© une visite protocolaire dans les cliniques de la ville ainsi que dans celles des villes voisines qui ne disposaient pas dâune installation aussi perfectionnĂ©e. Ils proposĂšrent leurs services aux responsables, en offrant des prestations Ă un tarif attractif. Ils avaient Ă©galement contactĂ© les staffs des MutualitĂ©s Sociales Agricoles et de lâĂquipement, Ă qui ils avaient proposĂ© dâeffectuer, Ă des coĂ»ts intĂ©ressants, des bilans sanguins et urinaires, dans le cadre de la prĂ©vention, pour les agriculteurs et les personnels de lâĂquipement. Les administrateurs de ces structures avaient Ă©tĂ© intĂ©ressĂ©s par leur offre. La prĂ©vention faisait en effet partie de leur action Ă long terme ; ils avaient Ă©tĂ© Ă©galement sĂ©duits par le prix trĂšs compĂ©titif de la prestation offerte, que la nouvelle automatisation des analyses permettait. Finalement ils avaient obtenu ces marchĂ©s.
Marion sâĂ©tait montrĂ©e intĂ©ressĂ©e par la dimension technique du projet, Ă©tant chimiste de formation. Elle avait donc participĂ© Ă son Ă©laboration, et ne pensait plus guĂšre Ă ces Ă©tranges pĂ©ripĂ©ties de La Retirais. Elle voulait mĂȘme oublier lâidĂ©e farfelue de son mari de la « dĂ©bloquer » psychologiquement en lâintroduisant dans un club Ă©changiste. Mais comment avait-il pu concevoir une supposition aussi irrationnelle ? Cela ne lui ressemblait guĂšre, pensait-elle, les rares fois oĂč ce souvenir dĂ©rangeant remontait Ă sa conscience. Les annĂ©es avaient passĂ©, et elle avait acceptĂ© le fait quâelle demeurerait stĂ©rile. Les consultations et les examens quâelle avait passĂ©s ne lui avaient pas laissĂ© dâespoir.
Elle apportait, au laboratoire, son concours ponctuel quand il était nécessaire, le plus souvent au plateau technique.
Elle sâĂ©tait dâabord occupĂ©e en meublant sa maison selon ses goĂ»ts, et en recourant aux services dâun dĂ©corateur pour les peintures et tapisseries. Elle aimait bien le mobilier de style Louis XVI, sobre et Ă©lĂ©gant et elle avait couru assidĂ»ment les ventes. Claude avait un net penchant pour le mobilier moderne mais il aimait les beaux matĂ©riaux. Elle avait choisi avec lui les meubles de rangement, les chaises et fauteuils ainsi que le bureau de la piĂšce quâil sâĂ©tait attribuĂ© comme cabinet de travail. Ce nâĂ©taient que formes nettes, chĂȘne clair en bois massif, mĂ©tal et grands plateaux de verre.
Un jour quâelle circulait Ă pied dans les rues de Blois, aprĂšs avoir effectuĂ© les quelques achats nĂ©cessaires Ă la prĂ©paration des repas de la journĂ©e, elle rencontra Duponchel, qui la salua avec empressement et engagea la conversation avec elle. Elle Ă©tait fort mal Ă lâaise de retrouver ce personnage, qui lui rappelait de mauvais souvenirs. Elle avait jusque-lĂ Ă©vitĂ© soigneusement de franchir le pont Jacques-Gabriel, en dos dâĂąne au-dessus de la Loire, et dâaller faire des emplettes dans le faubourg de Vienne, oĂč elle savait que M. Duponchel avait une boutique de prĂȘt-Ă -porter. AprĂšs les prĂ©liminaires dâusage, il lui demanda si son mari et elle Ă©taient retournĂ©s au club. Il nâavait pas eu le plaisir de lây revoir. Sur sa rĂ©ponse nĂ©gative, il sâĂ©tonna dâabord puis il dit avec un petit sourire :
« Vous ĂȘtes cependant un couple libĂ©rĂ© ! Je mâen suis rendu compte en vous voyant Ă La Retirais. Alors je vous parle en toute libertĂ©, moi aussi ! AprĂšs tout, il nâest pas nĂ©cessaire de se dĂ©placer jusquâĂ lâorĂ©e de la forĂȘt pour â comment dirais-je ? â prendre du bon temps. On peut trĂšs bien se retrouver dans cette ville. Que diriez-vous dâun goĂ»ter chez moi ? On pourrait faire plus ample connaissance et, comme on dit, aller plus loin, si affinitĂ©s ? Avec ou sans la prĂ©sence de nos conjoints, cela va sans dire⊠»
Elle resta dâabord interloquĂ©e, sans savoir quoi rĂ©pondre. Des envies de le gifler en pleine rue la dĂ©mangeaient. Il la fixait, avec un air complice et plein dâespoir au dĂ©but, puis le silence de la jeune femme commença Ă lâinquiĂ©ter, et cela se voyait dans son regard.
« Monsieur, je suis allĂ©e dans ce bouge sur la demande insistante de mon mari, et pour un motif que je nâai nulle intention de vous dĂ©voiler. Je vous dirai seulement que je nâavais aucune intention de jouer, dans ce club, le rĂŽle de la femelle en chaleur devant nâimporte quel mĂąle. Alors, non, merci.
â Oh, mais, ce nâest pas nĂ©cessaire de me faire la scĂšne de la grande dame outragĂ©e. Votre mari vous trompe allĂšgrement, lui ! »
Elle le regardait avec surprise. Il avait maintenant lâair de bien sâamuser, faisait durer lâattente et semblait enfin sâapprĂȘter Ă lĂącher une grosse blague :
« Voyez-vous, pendant que vous Ă©tiez Ă danser et Ă roucouler avec monsieur Ferri, il se passait des choses dans les petites salles. Je lâai appris aprĂšs votre dĂ©part ! Savez-vous ce quâil faisait, votre mari ?
â Il fumait un cigare avec ses deux amis dans le parc.
â Ah ! Ah ! Câest la meilleure. Vous voulez savoir la vĂ©ritĂ© ? Eh bien, je vais vous la dire de toute façon ! Il jouait, avec les deux messieurs et deux dames dĂ©complexĂ©es, Ă des jeux dĂ©conseillĂ©s aux petites filles, dans une des alcĂŽves de lâĂ©tage supĂ©rieur.
â Je ne vous crois pas !
â Bien sĂ»r. Ăa viendra. Ăa viendra plus tard. Mais je me suis aussi renseignĂ© avant de vous rencontrer. Je ne suis pas lĂ par hasard. Jâai le bras long, vous savez, et des relations que vous nâimagineriez mĂȘme pas. Je voulais faire aller les choses en douceur. Maintenant, aprĂšs vous avoir Ă©coutĂ©e, jâai changĂ© dâavis. VoilĂ : votre mari couche avec une secrĂ©taire de votre accueil, une certaine Patricia ; mais le bruit court aussi quâil lutine une femme de mĂ©nage, une pin-up de toute beautĂ©, reconnaissable Ă son type espagnol, paraĂźt-il. Mais jâavoue que jâai oubliĂ© son nom. Il doit sans doute avoir dâautres favorites mais je nâai recensĂ© que ces deux-lĂ . Câest un sacrĂ© coureur, votre mari ! Aussi, si jâĂ©tais vous, je profiterais de lâoccasion que je vous offre de lui rendre la monnaie de sa piĂšce ! Oh ! Un dernier dĂ©tail, qui fait un peu tache dans le tableau : il les paie. Eh bien oui, ne sursautez pas. Il faut bien rĂ©tribuer les courtisanes. Il leur fait aussi des cadeaux. Câest pas beau, ça ? »
Il Ă©tait tout excitĂ© et en devenait rĂ©pugnant. Le dĂ©guisement, avec le beau costume dans un coĂ»teux tissu, ne masquait plus la crapule quâil Ă©tait en rĂ©alitĂ©. Marion respira un grand coup.
« Une seule question, monsieur Duponchel. Pourquoi mettez-vous une drogue dans la coupe de vos proies ? Vous nâavez pas dâautre solution pour sĂ©duire des femmes et arriver Ă vos fins ? »
Il arrĂȘta net ses Ă©ructations et la regarda, Ă©bahi.
« Vous le saviez ? »
Elle eut un sourire terrible et lui tourna le dos puis elle sâĂ©loigna Ă grands pas.
Chapitre 5 - Trompée
Il faisait dĂ©cidĂ©ment trop chaud Ă proximitĂ© de la roseliĂšre, sur les bords de la riviĂšre marron. Les joncs, les massettes, et les roseaux secs craquaient doucement dans la faible brise intermittente, les iris dĂ©ployaient leurs grandes fleurs dâun jaune Ă©clatant au-dessus de la vase, parmi les plantains dâeau aux si larges feuilles dâun vert brillant. Dâinfatigables libellules, ces si Ă©lĂ©gantes demoiselles au fin corset vert, zigzaguaient rapidement dans lâair chargĂ© de lourdes et chaudes senteurs de terre dĂ©composĂ©e, puis restaient en vol stationnaire, leurs ailes transparentes vibrant frĂ©nĂ©tiquement. Toute la nature concourait Ă la retenir dans ce sanctuaire oĂč elle se sentait Ă lâabri de la mĂ©chancetĂ© des hommes ; mais il y faisait vraiment trop chaud, et les moustiques y devenaient de plus en plus agressifs.
En soupirant un peu, elle fit demi-tour, regagna le sentier herbu oĂč croissaient des orties, puis parvint Ă la petite route conduisant au village de Coulanges, franchit le pont au-dessus de la Cisse, et traversa la route qui aboutissait Ă Chambon. Elle aborda une sente Ă©troite, qui naissait de lâautre cĂŽtĂ© de la route. Elle rejoignait un peu plus loin le chemin qui montait depuis la route, Ă flanc de cĂŽteau, en direction dâun hameau de quelques fermes, tout en haut du plateau de la forĂȘt. LâallĂ©e des Courtauderaies commençait Ă gauche, deux cents mĂštres avant la premiĂšre ferme. Lâair Ă©tait dĂ©jĂ moins Ă©touffant, et le serait encore moins quand elle atteindrait lâallĂ©e des chĂȘnes, avant lâenclos du potager. Elle respirait fort quand elle arriva Ă la barriĂšre de sa propriĂ©tĂ©. La montĂ©e Ă©tait quand mĂȘme bien raide ! Elle sâarrĂȘta quelques minutes dans le mail, dont les Ă©normes chĂȘnes crĂ©aient une atmosphĂšre rafraichissante et ombreuse. En se rapprochant du haut mur qui protĂ©geait le potager, elle entendit les petits chocs de la binette du jardinier invisible creusant la terre.
Le jardinier Ă©tait un homme ĂągĂ©, qui vivait dans une petite maison, proche du portail. On lâappelait le closier. En pays de Loire, câest le tenant dâune petite mĂ©tairie ; mais le closier de la grand-mĂšre de Marion disposait de privilĂšges enviĂ©s par dâautres voisins. Il avait la jouissance gratuite de cette maisonnette depuis des temps immĂ©moriaux. Il y vivait avec son Ă©pouse toute voĂ»tĂ©e, et cultivait, sans payer de redevance Ă la propriĂ©taire, quelques arpents de terrain jusquâau chemin montant aux fermes. Il avait officiellement le statut et les gages modestes de concierge de la propriĂ©tĂ©, dont il Ă©tait le gardien. La grand-mĂšre dĂ©cĂ©dĂ©e lui avait aussi laissĂ© la jouissance du potager, Ă lâintĂ©rieur de la propriĂ©tĂ©, ainsi que la licence dây puiser de lâeau au puits, qui se dressait au milieu du jardin. Elle sâĂ©tait seulement rĂ©servĂ© le droit dây prendre de temps en temps une salade ou deux carottes, Ă sa convenance, et il lui apportait quelquefois un poulet de sa petite basse-cour ou un lapin du clapier. Mais câĂ©tait pure bĂ©nĂ©volence de sa part, et la vieille dame, soulignant le caractĂšre gratuit du cadeau, le remerciait chaleureusement et ne permettait pas quâil reparte sans quâil se fĂ»t assis Ă la table de la grande salle, la table des maĂźtres, et ait bu le cafĂ© quâelle lui servait, arrosĂ© de la goutte. Marion avait confirmĂ© les conventions tacites passĂ©es entre le closier et sa grand-mĂšre maintenant dĂ©cĂ©dĂ©e, et contresignĂ© le contrat qui lâinstituait concierge des Courtauderaies. Il avait aussi le droit de circuler dans le bois et dây prĂ©lever gratuitement le combustible dont il avait besoin, tant lâhiver, pour se chauffer, que le reste de lâannĂ©e, pour cuisiner dans la cheminĂ©e de la salle. Il veillait sur les rosiers mais Ă©tait trop ĂągĂ© pour continuer Ă faucher la prairie devant la terrasse du sud. Le closier se redressa quand il entendit la porte de service grincer, et regarda entrer Marion, qui lui sourit. Elle voyait mal son visage ridĂ©, dans lâombre du grand chapeau de paille un peu dĂ©foncĂ©, et il la salua dâun signe de tĂȘte, accompagnant un nasillard « Bonjour Maâame », aprĂšs quoi il empoigna Ă nouveau sa binette, se courba et recommença Ă casser les mottes de terre dessĂ©chĂ©es sans plus sâoccuper dâelle. Il nâavait jamais Ă©tĂ© causant.
Elle alla Ă la porte du manoir, dans lâangle de la tour, et poussa le vieux et lourd vantail en Ă©paisses planches sombres, patinĂ©es par les siĂšcles. La porte grinça. Elle entra dans la pĂ©nombre fraĂźche du corridor qui commandait lâaccĂšs Ă une chambre, au sud-ouest, Ă la cuisine, dans le fond, et Ă la tour, Ă droite. Mais devant elle une porte vitrĂ©e Ă double battant ouvrait sur la grande salle, qui donnait sur la cour dâhonneur par une large et haute fenĂȘtre, et sur la terrasse au midi par des portes-fenĂȘtres. Deux chambres en enfilade ouvraient sur le pignon au sud-est. Une autre petite chambre, le long de la piĂšce principale, avait sa fenĂȘtre sur la terrasse. Elle traversa la salle, sortit au soleil et descendit les quelques marches de la terrasse vers la prairie. Elle se dirigea vers le majestueux cĂšdre bleu qui avait Ă©tĂ© plantĂ© au milieu de la prairie bien des siĂšcles avant. Quand elle en approcha, elle sentit lâodeur balsamique si revigorante quâil exhalait. Une chaise longue lâattendait, sous lâombre du gĂ©ant, et elle sây installa, soupirant dâaise et fermant les yeux.
Elle revint Ă Blois, dĂ©terminĂ©e Ă savoir ce qui se passait vraiment entre son mari et les employĂ©s du laboratoire. Cela nâallait pas ĂȘtre facile de faire parler les gens, mais elle ne pouvait plus rester dans lâincertitude. Elle aurait voulu Ă©carter les nausĂ©euses allĂ©gations de Duponchel mais elle sentait, au fond dâelle-mĂȘme, que les choses nâĂ©taient pas aussi simples quâelle lâaurait voulu. Bien sĂ»r, que le tailleur escomptait dĂ©clencher une rĂ©action de vengeance de sa part envers Claude. Il vous a trompĂ©e abondamment, rendez-lui la monnaie de sa piĂšce et devenez ma maĂźtresse ! Il aurait mĂȘme trĂšs bien pu tout inventer pour arriver Ă ses fins. Mais elle errait dans un labyrinthe de souvenirs ; elle les examinait un Ă un, en les Ă©tudiant anxieusement. Elle se demandait si son interprĂ©tation de certains Ă©vĂ©nements, des phrases entendues, des regards, des sourires, nâĂ©tait pas complĂštement fausse. Maintenant quâelle avait entendu les allĂ©gations du tailleur, et quâelle se remĂ©morait ces petits riens, une tout autre explication, cruelle pour elle, sâĂ©panouissait dans son esprit. Duponchel a Ă©tĂ© en fait mon Leporello ! Il mâa chantĂ© il catalogo Ăš questo, le catalogue des maĂźtresses.Je ne sais si Claude Ă©gale les performances de don Giovanni⊠Mais quâest-ce que je raconte ? Tu deviens folle, ma fille !
Elle essayait dâoublier la soirĂ©e au club de la forĂȘt, et les propos brĂ»lants de Lucifer. Le premier, il avait accusĂ© Claude de forniquer avec des partenaires, venues aussi pour le sexe Ă La Retirais. Duponchel nâavait fait que confirmer le vice de son Ă©poux, et le banaliser en quelque sorte.
Sa premiĂšre entreprise fut de coincer Catherine, une infirmiĂšre au visage ingrat et Ă lâhumeur aigrie, dans une cabine de prĂ©lĂšvement du laboratoire. Elle avait dĂ©cidĂ© de lâattaquer frontalement :
« Catherine, mon mari me trompe avec des femmes du labo. Vous ĂȘtes au courant ? »
Lâautre la regarda, interdite dâabord, et gĂȘnĂ©e, avec les yeux agrandis et la bouche entrouverte. Elle restait tĂ©tanisĂ©e et les secondes sâĂ©coulaient, embarrassantes.
« Vous savez, Catherine, ce nâest pas vraiment une surprise. Je mây attendais. Mais quand mĂȘme, câest dĂ©sagrĂ©able. Une femme de mĂ©nage, une secrĂ©taire⊠Vous ne feriez pas des choses comme ça, Catherine, jâespĂšre.
â Oh ! Bien sĂ»r que non, Madame. Je nâaccepterais jamais une saloperie pareille. Excusez mon vocabulaire, maisâŠ
â Je vous en prie ! Mais comment Patricia a-t-elle pu en arriver lĂ ? Et lâautre aussiâŠ
â Mais parce que Patricia est une garce, Madame. Une garce finie ! DĂšs quâelle voit un homme, il faut quâelle tortille du popotin ! Alors, quand Monsieur sâest intĂ©ressĂ© Ă elle⊠Et puis â elle baissa la voix â Monsieur la rĂ©compenseâŠ
â Vous voulez dire quâil la paie pour ses faveurs ? »
Elle eut un battement de paupiĂšres complice, et sourit dâun air mauvais.
« Une garce, je vous dis. Et il lui fait des cadeaux ! Tenez, le bracelet en or quâelle a depuis peu. Ne cherchez plus qui le lui a payĂ©. Et, Madame, elle a mĂȘme lâaudace de sâen vanter ! « Câest Monsieur qui me lâa offert. »
â Et câest la mĂȘme chose pour la femme de mĂ©nage ?
â Exactement ! La MarĂa de los Ăngeles se fait sauter dans le placard Ă balais, si vous voulez savoir. Câest une honte ! On entend ses gĂ©missements quand on passe dans le couloir et quâelle y est enfermĂ©e avec Monsieur. Je me dĂ©pĂȘche alors et je me sauve Ă lâautre bout du couloir, comme si câĂ©tait moi qui devais rougir.
â Et elle a droit aux cadeaux comme lâautre ?
â Pareil ! Madame. Les honnĂȘtes femmes, comme moi, nous en sommes toutes retournĂ©es !
â Parce que toutes les autres employĂ©es nâacceptent pas les propositions de Monsieur ? »
Lâautre eut un hennissement de mĂ©pris. Maintenant quâelle Ă©tait lancĂ©e, elle voulait vider son sac et cracher ce quâelle pensait de ses collĂšgues.
« Jâai honte de vous rĂ©pondre ça, Madame. Mais jâen connais qui ne seraient pas fĂąchĂ©es que le patron les entreprenne ! Et elles le susurrent, ces garces, en roulant les yeux ! Ăa fait rire les autres. Comme si câĂ©tait drĂŽle ! Elles plaisantent, quâelles disent, mais⊠Seulement, pour ĂȘtre tout Ă fait honnĂȘte, et pour revenir Ă votre question, je ne peux pas dire que jâen connaisse dâautres, Ă passer Ă la casserole. Ăa ne veut pas dire quâil nây ait que ces deux-lĂ , remarquez ! Mais on nâen entend pas parler. »
Marion la remercia et sortit de la minuscule piĂšce, soupçonnant la pauvre femme, quoi quâelle en dise, dâaspirer Ă devenir, elle aussi, une nouvelle AziyadĂ©, et de se retrouver enfermĂ©e avec Claude, dans le placard Ă balais⊠Oh, bien sĂ»r, la rĂȘverie ne se dĂ©roulait pas dans le champ le plus clair de la conscience. La pensĂ©e sâĂ©gare, elle descend un peu contre son grĂ© dans un trĂšs long et obscur escalier en colimaçon, qui mĂšne aux caves et aux tĂ©nĂ©breux souterrains de notre esprit, lĂ oĂč sont abandonnĂ©s et gĂ©missent sourdement bien des songes inavouables. Câest dans ces cavernes infernales que les dĂ©pits et les dĂ©sirs de revanche prennent corps. Car nous sommes tous un peu schizophrĂšnes ! Une voix, comme une trompette, nous invite Ă suivre un chemin au grand jour, sous la lumiĂšre Ă©clatante du soleil, vers lâimmense stade en fĂȘte, creusĂ© au sommet de la montagne, afin dâĂ©clater de joie en compagnie de nos frĂšres humains ; lâautre nous susurre dâun murmure enjĂŽleur de nous glisser, sous lâobscuritĂ© complice, dans le hallier des bĂȘtes sauvages, et de nous joindre Ă la meute affamĂ©e en quĂȘte muette dâune proie.
CâĂ©tait bien parce que Marion subodorait que lâenvie et la jalousie pouvaient dĂ©vorer cette femme disgraciĂ©e, quâelle lâavait entreprise la premiĂšre. Elle imagina un instant lâambiance qui devait rĂ©gner dans le palais de Topkapi Ă Istanbul, parmi toutes ces femmes roumis, soumises au bon plaisir du sultan, et rĂȘvant dâĂȘtre reconnues comme la favorite, lâĂ©pouse du seigneur. Dans le rĂšgne animal, les cerfs ou les lions combattent entre eux. Seul le plus fort est agrĂ©Ă© par les femelles, qui les regardent sâaffronter et ne veulent ĂȘtre fĂ©condĂ©es que par la semence du meilleur. La sociĂ©tĂ© humaine reproduit ce comportement, dictĂ© par la sĂ©lection, pensa Marion avec mĂ©lancolie : les femmes nâont rien Ă refuser aux mĂąles dominants, aux chefs. Mieux encore, elles se dĂ©mĂšnent pour sâen faire remarquer et sâattirer leurs faveurs.
Elle revint au monde rĂ©el et soupira. Des employĂ©s passaient prĂšs dâelle et la saluaient en la regardant un peu trop longtemps. Elle devait avoir une drĂŽle dâexpression, songea-t-elle soudain. Elle leur rĂ©pondit avec un mot gentil et rejoignit la porte intĂ©rieure, qui permettait de passer du laboratoire Ă sa maison. Une fois la porte refermĂ©e, elle gagna son salon. Les deux piĂšces de rĂ©ception, en rez-de-chaussĂ©e surĂ©levĂ©, traversaient la maison. La salle Ă manger donnait sur la rue, le salon disposait dâun bow-window largement ouvert sur le jardin. Elle choisit une bergĂšre et sây installa. Elle perdit trĂšs vite de vue les massifs de fleurs, et plongea dans ses pensĂ©es moroses comme dans les eaux grises dâun Ă©tang marĂ©cageux.
Ainsi, Lucio Ferri et Duponchel avaient dit vrai. Elle se remĂ©mora alors les premiers temps de leur amour, ces soirĂ©es Ă lâOpĂ©ra et cette phrase de Claude quâelle lui avait reprochĂ©e. Ils venaient dâassister au Don Giovanni et Claude parlait du grand seigneur et de ses conquĂȘtes. Il comparait les femmes Ă quoi, dĂ©jĂ ? Ă des citadelles Ă investir ? Ă des proies Ă conquĂ©rir ? Oui, câĂ©tait ses mots. Ils lâavaient fortement marquĂ©e. Cela lui avait fort dĂ©plu, et elle lui avait demandĂ© sâil Ă©tait lui aussi un don Juan. Quâelle Ă©tait naĂŻve ! Ils avaient Ă©tĂ© brouillĂ©s pendant des semaines parce quâelle sâĂ©tait refusĂ©e Ă lui, et elle se souvenait maintenant des confidences de ses camarades qui lâavaient mise en garde contre Claude, « un coureur de jupons ». Elle avait cru quâil avait mĂ»ri et que leur vie conjugale le satisfaisait. Toujours aussi naĂŻve !
Et maintenant, quâallait-elle faire ? Fermer les yeux et faire comme si elle ne savait rien ? CâĂ©tait une option bien tentante ! Elle se sentait lasse, presque rĂ©signĂ©e. Ils vivaient ensemble depuis une bonne vingtaine dâannĂ©es et elle se satisfaisait jusque lĂ de cette situation. Elle lâaimait, son Claude. Elle aimait tout de lui, ses grands yeux marron pĂ©tillant dâintelligence, son sourire plein de tendresse quand il la regardait, son visage peut-ĂȘtre un peu plus empĂątĂ© que lorsquâelle lâavait connu dans sa jeunesse, son corps encore leste, son savoir-faire quand ils se retrouvaient au lit. Elle se sentait un peu honteuse dâavoir de telles pensĂ©es, surtout aprĂšs vingt ans de vie commune, mais il fallait quand mĂȘme bien aller jusquâau bout du bilan, non ?
Elle pouvait aussi provoquer une explication. Elle nâallait certes pas remonter Ă lâĂ©poque de leurs Ă©tudes et Ă sa rĂ©putation de coureur de femmes. Dâailleurs, elle avait enfoui ce souvenir dans son subconscient, et il avait fallu cette crise pour quâil remonte Ă la surface. Mais elle pouvait lui demander des comptes sur ses coucheries avec Patricia, Patricia et son bracelet en or, Patricia et ses vantardises, ainsi que sur MarĂa de los Ăngeles, la brune Espagnole au sang chaud, quâil faisait gĂ©mir dans le placard Ă balais. Que câĂ©tait sordide, mon Dieu ! Et combien dâautres, dont elle nâavait pas connaissance ? Il nierait certainement. Il demanderait dâoĂč elle tenait ces rumeurs. Elle nâallait sĂ»rement pas mettre en cause Catherine, cette pauvre fille.
Elle pouvait enfin divorcer. Mais Ă quel prix ? Comment justifier sa demande ? LâadultĂšre rĂ©pĂ©tĂ© constituait certainement une cause recevable ; mais il lui faudrait alors en apporter une preuve irrĂ©futable. Ce nâĂ©tait pas la dĂ©position dâune femme hargneuse qui suffirait au juge. Dâautre part, leur mariage avait Ă©tĂ© encadrĂ© par un contrat, nĂ©gociĂ© par leurs parents, pour parer Ă toute Ă©ventualitĂ©. Des intĂ©rĂȘts Ă©taient en jeu. Le divorce constituait une option brutale, qui ne la tentait pas. Du moins, pas encore. Elle devait bien se lâavouer : elle continuait Ă tenir Ă son mari. Oui, malgrĂ© ce quâelle venait dâapprendre, et qui lui paraissait tout Ă fait assurĂ©, puisque venant de deux sources distinctes, elle aimait encore cet homme infidĂšle. Elle voulait se persuader quâil lâaimait encore, lui aussi, et que son comportement Ă©tait provoquĂ© par cette constitution masculine, dont il lui avait parlĂ© lorsquâils Ă©taient jeunes, au sortir de Don Giovanni : « les hommes pourchassent les femmes comme des proies Ă conquĂ©rir. Câest dans leur nature. »
Elle ressentit soudain une bouffĂ©e de chaleur et la rage sâempara dâelle. Elle se releva brusquement et se mit Ă marcher Ă grands pas dâune piĂšce Ă lâautre. Comme câĂ©tait facile de justifier des trahisons en invoquant lâaction de ses hormones ! Ce nâest pas de ma faute, vois-tu, chĂ©rie, mais celle de ma libido, tu sais, la testostĂ©rone. Câest dans ma nature. VoilĂ un bon argument Ă prĂ©senter aussi Ă un juge, songea-t-elle avec ironie : jâai rouĂ© de coups mon voisin mais, monsieur le juge, ce nâĂ©tait pas volontaire, je nây suis pour rien ; câest Ă cause de ma testostĂ©rone.
Elle lança soudainement un grand cri de colÚre et de frustration. Puis elle rit nerveusement, soulagée.
Chapitre 6 - Le projet tourangeau
Elle avait attendu avec anxiĂ©tĂ© le retour de Claude, nâarrivant pas Ă dĂ©cider ce quâelle allait faire. Parler ? Se taire ? Elle avait prĂ©parĂ© le dĂźner : un potage de lĂ©gumes fait de la veille, et des endives farcies quâelle avait mĂ©ticuleusement prĂ©parĂ©es avec un peu de lait, un Ćuf, de la chair Ă saucisse, et une pincĂ©e de muscade rĂąpĂ©e. Ce travail effaça un temps de son esprit les questions quâelle se posait sans arrĂȘt. Elle avait prĂ©cuit au four sa prĂ©paration puis, ignorant lâheure exacte du retour de son mari, elle avait retirĂ© le plat du four. Elle lây remettrait un quart dâheure avant de le servir. Un laitage et la corbeille de fruits â cerises et fraises â complĂ©teraient le menu. Elle disposa le couvert sur la nappe de la table, dans la salle Ă manger, et dĂ©posa la corbeille de pain, lâeau et le pichet de vin. Elle avait ensuite descendu les quelques marches qui menaient au jardin et, munie du sĂ©cateur, elle avait visitĂ© les massifs de fleurs, coupant les roses flĂ©tries quâelle jetait dans un panier dâosier. De temps Ă autre, le visage dâun employĂ© apparaissait quelques instants aux fenĂȘtres du laboratoire, qui donnaient sur lâespace vert. Lâheure avançait, et les employĂ©s quittĂšrent les salles du laboratoire pour rentrer chez eux. Marion avait regagnĂ© le salon oĂč, assise dans un fauteuil, elle sâefforça sans grand succĂšs de lire un hebdomadaire. Elle apprĂ©hendait la confrontation avec son mari, car elle avait finalement dĂ©cidĂ© de parler.
Enfin elle perçut le bruit de la clé dans la serrure. Quelques instants plus tard, la porte claqua et elle entendit la phrase familiÚre :
« Bonsoir chĂ©rie ! Câest moi ! »
Il entra dans la grande piĂšce de sĂ©jour et avisa sa prĂ©sence dans le salon. Il vint vers elle en lui faisant un grand sourire. Il avait retirĂ© son veston dâĂ©tĂ©, quâil accrocha en passant au dossier dâun fauteuil, et ĂŽta sa cravate. Elle sâĂ©tait levĂ©e et il la prit par les Ă©paules pour lâembrasser. Ensuite il la tint Ă bout de bras en souriant :
« Alors ? Quâas-tu fait aujourdâhui ? Tu as jardinĂ© ?
â Non. Jâai pris la voiture et je suis allĂ©e Ă Chambon. Jâai voulu descendre au bord de la Cisse mais il y faisait trop chaud et les insectes y Ă©taient agressifs. Alors je suis remontĂ©e sur les hauteurs et je me suis installĂ©e Ă lâombre du grand cĂšdre. Jây ai un peu lu et somnolĂ©. Jây ai aussi rĂ©flĂ©chi.
â Ah bon ? De quoi ?
â De choses et dâautres. Mais dĂźnons. Jây reviendrai aprĂšs le repas. Je vais rĂ©chauffer le potage et les endives.
â Des endives farcies ? Excellent ! »
Il se frotta les mains puis sâaffala dans un fauteuil en soupirant dâaise. Elle Ă©tait passĂ©e dans la cuisine et elle sâaffaira Ă allumer le gaz sous la casserole de potage puis Ă remettre en route le four.
Ils prirent leur repas et Claude fit les frais de la conversation en racontant ses deux journées, passées à rencontrer plusieurs clients, des médecins qui travaillaient dans des cliniques et les représentants de plusieurs administrations, qui envisageaient de passer un contrat de suivi médical pour leurs salariés avec le laboratoire. Il avait passé la nuit à Tours pour honorer un rendez-vous matinal dans la banlieue de la ville.
Marion dĂ©barrassa prestement la table et poussa la desserte sur roues vers la cuisine. Son mari sâapprĂȘtait Ă se lever pour prendre son cartable, dĂ©posĂ© Ă lâentrĂ©e du salon, et gagner son bureau. Elle lâarrĂȘta :
« Sâil te plaĂźt, Claude, demeure ici encore un peu. Il faut que nous parlions et ce ne sera pas long, jâespĂšre. Je souhaite que nous nâayons pas de secrets lâun pour lâautre. Câest le cas en tout cas pour moi. Je ne tâai jamais rien cachĂ©. Or je crois quâil nâen est pas de mĂȘme pour toi.
â Mais que vas-tu chercher ?
â Non, attends. VoilĂ . â Elle hĂ©sitait encore, puis elle se lança â. Je viens dâapprendre que tu entretiens une relation avec Patricia et Ă©galement avec MarĂa.
â Hein ? Quâest-ce que câest encore, cette histoire ?
â Je lâai appris de deux sources diffĂ©rentes, nâayant pas de lien entre elles. Autant dire quâelles sont fiables. Tu comprendras que je nâaie pas interrogĂ© les intĂ©ressĂ©es.
â Mais enfin, ma chĂ©rie, tu ne me crois pas capable dâavoir une liaison avec ces femmes ! »
Marion ne rĂ©pondit pas. Elle le regardait fixement. Le temps passait et le silence devenait trĂšs pesant. Claude Roberteau restait figĂ© sur sa chaise. Il avait dĂ©tournĂ© les yeux et son regard semblait se perdre dans la contemplation de la fenĂȘtre de la rue. Ses mains reposaient sur la table ; sa main droite lissait machinalement la nappe et lâon nâentendait que le bruit tĂ©nu de son frottement. Sans dĂ©tourner le regard, il dit soudain Ă voix basse :
« Pardon ! »
Marion ne bougea pas et ne rĂ©pondit rien. Un nouveau silence sâinstalla. Puis :
« Je suis⊠Je suis dĂ©solĂ© et jâai honte. Oui, jâai eu une ou deux relations avec ces femmes.
â Une ou deux ? siffla dâune voix rauque Marion.
â Oui, enfin, je ne sais plus. Peut-ĂȘtre un peu plus.
â Comment, mais comment peux-tu me faire ça ? Notre vie conjugale ne te satisfait pas ? Câest ça ?
â Si, bien sĂ»r. Mais, comment tâexpliquer ? Patricia a eu des attitudes provocantes et⊠Enfin, jây ai rĂ©pondu. Pareil avec la femme de mĂ©nage. Bon, je ne vais pas te faire un dessin.
â Oh ! Excuse-moi de te rĂ©clamer des explications !
â Mais non, ce nâest pas ça du tout ! Je suis horriblement gĂȘnĂ© ! Je ne sais pas comment mâexprimer ! Je me rends compte que je suis trĂšs maladroit.
â Mais, Claude, je ne te demande pas dâĂȘtre adroit ou maladroit, seulement dâĂȘtre franc, dâĂȘtre honnĂȘte avec moi. Je veux comprendre pourquoi tu as trahi tes engagements Ă mon Ă©gard. Tu mâavais demandĂ© en mariage, tu te le rappelles ? Ce nâĂ©tait pas un simple acte social, mais une promesse, que tu mâavais faite, Ă moi, pas Ă nâimporte qui, Ă moi, Marion, Ă cette occasion : celle de mâĂȘtre fidĂšle et de mâaimer jusquâĂ ce que la mort nous sĂ©pare. Tu avais prononcĂ© ces mots. Peut-ĂȘtre un peu grandiloquents, jâen conviens ; « jusquâĂ ce que la mort⊠». Mais tu avais promis tant que tu Ă©tais vivant dâĂȘtre fidĂšle Ă une fille du nom de Marion. Et Marion, câest moi ; ce nâest pas Patricia ou MarĂa de los Ăngeles, ou je ne sais quelle autre poule. »
Elle sâĂ©nervait et tenta de retrouver un ton plus mesurĂ©.
« Or tu viens, je le rĂ©pĂšte, de trahir ta parole, et dâen convenir, lĂ , Ă lâinstant. Sois autant maladroit que tu veux, mais explique-toi, bon sang !
â Le dĂ©mon de midi⊠Je ne sais pas. Je nâai aucune excuse. Jâen conviens. »
Il releva enfin la tĂȘte et la regarda, penaud. Comme un petit garçon pris en faute, songea amĂšrement Marion. Il se leva et se mit Ă marcher de long en large, tĂȘte inclinĂ©e, les sourcils froncĂ©s et lâair boudeur, depuis la fenĂȘtre de la salle Ă manger jusquâau bow-window, Ă lâopposĂ© de la grande salle. Il passait devant sa femme, immobile, en lui jetant au passage un rapide coup dâĆil. Enfin il sâarrĂȘta en face dâelle et la regarda bien en face.
« Câest une trahison impardonnable, oui, jâen conviens. Il ne faut pas que je cherche des prĂ©textes ou des excuses. Eh bien, je vais abandonner le labo, dont je vais laisser la responsabilitĂ© Ă notre associĂ©. Je vais crĂ©er une nouvelle structure Ă Tours.
â Tu ne mâen avais pas parlĂ©, auparavant.
â Non, et je ne pensais pas tâen parler ce soir. Câest seulement un projet, encore bien vague. Jâai juste posĂ© quelques jalons. Mais les circonstances⊠Alors, voilĂ de quoi il sâagit. »
Il sâarrĂȘta et rĂ©flĂ©chit un peu avant de reprendre son explication. Elle Ă©tait fascinĂ©e : il occultait dans son esprit lâaccusation dont il Ă©tait lâobjet, et changeait de sujet pour aborder des questions professionnelles, voire techniques, dans lesquelles il se sentait Ă lâaise ! Mais peut-ĂȘtre aussi Ă©tait-ce une stratĂ©gie de contournement.
« Nous avons dĂ©jĂ des clients, au labo de Blois, qui sont des institutionnels et qui nous apportent de gros volumes dâanalyse. Je voudrais lancer un nouveau concept Ă Tours : jâai contactĂ© plusieurs MutualitĂ©s Sociales Agricoles ainsi que des organismes Ă©quivalents. Ils seraient intĂ©ressĂ©s par des services Ă un coĂ»t encore moindre que ceux qui leur sont facturĂ©s, et pour des prestations dâune qualitĂ© Ă©quivalente.
â Et comment comptes-tu arriver Ă cette rĂ©duction des coĂ»ts ?
â De plusieurs façons. Dâabord, jâexternaliserai les prĂ©lĂšvements. Des infirmiers indĂ©pendants, engagĂ©s par un contrat, se chargeront dâapporter les flacons dans la nouvelle structure. Ensuite, celle-ci sera installĂ©e en zone pĂ©riphĂ©rique, voire mĂȘme dans un entrepĂŽt rĂ©amĂ©nagĂ©. Nous nâaurons plus Ă nous soucier de lâapparence des locaux. Ce sera un laboratoire purement dĂ©diĂ© Ă des tĂąches de laboratoire, sans la moindre fioriture, que ce soit architecturale ou dĂ©corative. Une usine. Et enfin, nous emploierons seulement le personnel nĂ©cessaire au fonctionnement des machines. Car je compte mĂ©caniser le travail, utiliser comme dĂ©jĂ ici des automates, et mettre en place en amont des ordinateurs. Jâai sĂ©rieusement travaillĂ© la technique du codage de programmes informatiques â tu sais que jâai passĂ© une licence scientifique, il y a vingt ans, et que jâai continuĂ© Ă mâintĂ©resser aux derniĂšres Ă©volutions dans le domaine numĂ©rique. Mais je ferai nĂ©anmoins appel Ă un informaticien spĂ©cialisĂ© ; Ă nous deux, on devrait pouvoir crĂ©er une interface nĂ©cessaire entre un ordinateur et un automate, entre lâintroduction, au sein des automates, des donnĂ©es liĂ©es aux prĂ©lĂšvements, au moyen de codes-barres lus par les machines, et les rĂ©sultats des analyses, en fin de cycle, entreposĂ©s dans les mĂ©moires des ordinateurs puis imprimĂ©s pour envoi aux clients institutionnels. On ne travaillera pas pour monsieur Dupont ou madame Durand, mais pour une entitĂ© regroupant mille individus, voire plus.
â Oui, je comprends ton projet. Mais, dans tout ça, et tes petits adultĂšres ? »
Il blĂȘmit et la regarda, brusquement ramenĂ© au sujet si pĂ©nible et humiliant de sa faute, alors quâil sâĂ©panouissait dans la vision de sa future entreprise.
« Je te lâai dit, Marion. Ăa va se passer Ă Tours. Je serai donc trĂšs souvent rendu Ă Tours et je nâaurai pas le temps de mâoccuper du labo de Blois. Je reviendrai, bien sĂ»r Ă la maison, mais je prĂ©voirai aussi, dans la future structure, un logement. Notre associĂ© est parfaitement capable de diriger le labo et, si tu le dĂ©sires, tu pourras tâinvestir un peu plus dans son fonctionnement. Tu as des parts dans le capital de lâentreprise et tu peux surveiller ce qui sây passe. Bien sĂ»r, tu nâeffectueras pas de prĂ©lĂšvements sanguins ou autres. LĂ nâest pas la question. Mais il y a bien des domaines dans lesquels tu peux intervenir, en cas de besoin. Quant Ă moi, je ne verrai plus ici ni les secrĂ©taires, ni les femmes de mĂ©nage. Est-ce que cela rĂ©pond Ă ta question ?
â Oui. Cela rĂ©pond Ă ma question. Tu nâas pas autre chose Ă me dire ?
â Je te le rĂ©pĂšte, Marion, je suis vraiment dĂ©solĂ© et honteux. Je te demande de ma pardonner. Sâil te plaĂźt ! »
Elle fit un pas et sâapprocha de lui pour mieux plonger son regard dans les yeux marron quâil ne baissa pas. Son visage exprimait une grande Ă©motion. Mais Ă©tait-ce Ă cause du regret de sa trahison, ou parce quâil sâĂ©tait fait prendre ? Elle ne le saurait sans doute jamais.
« Je te pardonne, Claude. Je te pardonne, mais je suis malheureuse, bien malheureuse. Je commence Ă avoir du mal Ă te croire, vois-tu. Comment ĂȘtre sĂ»re de toi, sĂ»re de ta parole ? AprĂšs ces trahisons ? AprĂšs la Retirais ? Non, ne dis rien. Mais je vais essayer, moi aussi. »
Ce quâelle ne dit pas, câest la douleur qui lui tordait le cĆur. Elle le scrutait avec intensitĂ© de ses yeux bleus grands ouverts ; cet homme infidĂšle Ă©tait pourtant la mĂȘme personne que le beau jeune homme quâelle avait frĂ©quentĂ©, bien des annĂ©es avant, Ă Paris. Peut-ĂȘtre un peu alourdi et empĂątĂ©. Et encore. Il avait maintenant vingt ans de plus. Elle aussi, elle avait changĂ©, maigri, jauni. Elle sâĂ©tait un peu flĂ©trie, pensa-t-elle sans complaisance. Ainsi va la vie. Pourtant elle retrouvait face Ă elle son Claude, avec ce corps bien proportionnĂ©, son visage aux traits rĂ©guliers, souriant facilement avec bonhomie, et regardant les autres de ses yeux marron pĂ©tillants de bonne humeur et dâempathie. Elle sâattarda sur le regard de Claude, quâil posait sur les autres avec, Ă la fois, de la tendresse et une particuliĂšre perspicacitĂ©. Claude, son Claude, un homme Ă lâintelligence acĂ©rĂ©e, qui se projetait tout le temps dans lâavenir. Un homme dont elle Ă©tait tombĂ©e amoureuse sans en prendre conscience. Elle se considĂ©rait comme une femme Ă lâesprit cartĂ©sien, une scientifique, et elle Ă©prouvait la plus grande perplexitĂ© lorsquâelle sâinterrogeait sur ce processus irrĂ©ductible Ă lâanalyse raisonnĂ©e, qui lâavait plongĂ©e dans les affres et les ravissements de lâamour. Du jour au lendemain, Claude avait occupĂ© ses pensĂ©es et elle Ă©tait incapable dâexpliquer quand et comment elle sâĂ©tait prise Ă lâaimer.
Elle se morigĂ©na. En rĂ©alitĂ©, elle ressortait lĂ une formule Ă©culĂ©e qui correspondait mal Ă la rĂ©alitĂ© du processus de lâamour. Cette prise de conscience de son amour ne sâĂ©tait pas effectuĂ©e du jour au lendemain. Câest une invention des poĂštes et des romanciers. Ce raccourci venait dâune reconstruction des Ă©vĂšnements dans sa mĂ©moire. Elle sâĂ©tait en rĂ©alitĂ© attachĂ©e Ă Claude de plus en plus. Il avait progressivement envahi le champ de sa pensĂ©e. Ce fut plusieurs semaines, aprĂšs sa rencontre, quâelle osa exprimer les mots, avec un infini Ă©tonnement et un trouble profond, qui traduisaient la vague qui la submergeait, lorsquâelle se tenait Ă cĂŽtĂ© du beau Claude.
MĂȘme si lâĂ©vĂšnement sâĂ©tait produit vingt ans plus tĂŽt, elle sâen souvenait parfaitement. Elle sâĂ©tait montrĂ©e incapable dâexpliquer Ă une bonne copine, qui sâĂ©tonnait de cette amourette pour un vilain sujet volage, comment elle en Ă©tait tombĂ©e amoureuse.
« Mais enfin, ma pauvre fille, te rends-tu compte que câest un triste sire, en dĂ©finitive, ton Claude ? Toutes les filles sâen mĂ©fient comme de la peste, toutes, tu mâentends bien ? Il a une belle petite gueule dâange, ça, je ne le conteste pas. Il a les plus beaux yeux du monde, je te lâaccorde aussi. Il a une voix douce et il parle comme chantaient les sirĂšnes aux oreilles dâUlysse. Mais tu ne dois justement pas lâĂ©couter ! Tu nâauras plus que tes yeux pour pleurer quand il se dĂ©sintĂ©ressera de toi pour courir le guilledou avec dâautres minettes. Car, je te le dis, il a dĂ©jĂ brisĂ© le cĆur de plusieurs Ă©tudiantes. Il est rĂ©putĂ© ĂȘtre un don Juan qui nâa quâune obsession : mettre la fille quâil convoite dans son lit ; et quand il sâen est rassasiĂ© et lassĂ©, basta ! »
Mais elle nâavait pas voulu entendre ces propos crus et brutaux. On faisait un mauvais procĂšs Ă ce pauvre garçon ! Une fille, furieuse quâil nâeĂ»t pas rĂ©pondu Ă ses avances, lâavait sans doute calomniĂ© en rĂ©pandant dans le milieu Ă©tudiant ces propos fielleux. Il Ă©tait peut-ĂȘtre dâun tempĂ©rament voluptueux, de cela Marion pouvait tĂ©moigner aussi, mais elle refusait de croire Ă sa duplicitĂ©. Il Ă©tait si tendre et charmant ! Les mots dâamour quâil lui murmurait lui avaient chavirĂ© le cĆur, et elle ne pouvait tout simplement pas croire quâil lui eĂ»t menti. Enfin ! Elle nâĂ©tait pas une fille naĂŻve ! Dâautres garçons lui avaient contĂ© fleurette et elle nâavait pas Ă©tĂ© longue Ă percer Ă jour leurs intentions ! Claude, lui⊠Non. Ce nâĂ©tait pas possible. Elle ne se serait pas trompĂ©e Ă ce point.
VoilĂ les pensĂ©es sans fin qui avaient fort troublĂ© son esprit dans sa jeunesse, jusquâĂ cette dĂ©marche repentante de Claude qui Ă©tait finalement venu la demander en mariage avec des mots qui lâavaient bouleversĂ©e. Depuis, les annĂ©es sâĂ©taient Ă©coulĂ©es, marquĂ©es par des projets nĂ©s dans lâesprit inventif et toujours en Ă©bullition de Claude. Cela avait Ă©tĂ© une belle aventure, ternie par sa stĂ©rilitĂ©. Car elle sâĂ©tait persuadĂ©e que Claude nâĂ©tait pas en cause, bien quâil eĂ»t refusĂ© de se plier Ă des examens pour en avoir le cĆur net.
« Allons, ma douce, ne cherchons pas un responsable ! Es-tu stĂ©rile ? Suis-je stĂ©rile ? Quâimporte. Nous sommes heureux ensemble et cela seul compte Ă mes yeux. Lâautre Ă©pisode qui avait Ă©galement terni leurs relations Ă©tait cette soirĂ©e au club Ă©changiste. Comment son mari avait-il pu la convaincre de se rendre Ă la Retirais ? Ou plutĂŽt comment avait-elle pu accepter cette proposition ?